Accueil > 05 - Livre Cinq : ECONOMIE POLITIQUE > 5- L’économie mondiale en route vers une nouvelle crise systémique qui en (...) > Nouvelle crise mondiale et limites du capitalisme
Nouvelle crise mondiale et limites du capitalisme
vendredi 17 décembre 2010, par
Voici ce que nous écrivions dès le début de la crise de 2008 :
Des milliers de milliards, ce sont les sommes que les Etats de la planète injectent dans l’économie pour pallier à l’incapacité de la classe capitaliste à faire du profit par l’investissement privé. Des trusts aussi productifs que General Motors, Chrysler, General Electric, les fleurons U.S. de l’industrie de consommation, ne survivent plus que par le truchement des injections d’argent public.
Et ces sommes ne sont jamais suffisantes ce qui signifie que la crise de l’endettement qui a gagné toute l’économie est en train de mettre en faillite les Etats. Et pourtant, cela ne peut pas être une manière de relancer l’économie capitaliste qui est fondée sur l’investissement privé de capital. Les banques aidées rechutent peu de temps après car les mêmes causes entraînent les mêmes effets, ce qui montre que les causes fondamentales de la crise ne sont enrien soignées par ces injections massives d’argent étatique. On peut donc bel et bien dire que le capitalisme est en panne bien plus qu’en 1929 et que les conséquences ne seront pas seulement un recul social sans précédent avec des licenciements massifs et une misère d’ampleur exceptionnelle. Les classes dirigeantes ont choisi de retarder cet effondrement afin de préparer une réponse. Celle-ci comprendra certainement une répression accrue des travailleurs, la remise en cause des libertés et la marche à la guerre ... mondiale. Sans être devin, cet avenir est assuré si... les travailleurs et les peuples n’y mettent pas le hola ! Ils en ont la force. Ils sont la plus grande puissance à l’échelle mondiale. Il leur manque la conscience de cette force et de cette perspective.
N’acceptons pas la logique destructrice du capitalisme en crise
L’économiste Frédéric Lordon : "Spécifique, générique, la crise est singulière également. Cette crise financière n’est pas que financière. Surtout, comme aucune autre auparavant elle exprime les contradictions du régime d’accumulation en vigueur et signale son arrivée aux limites."
A l’instar de Patrick Artus, chef économiste de Natixis, et de Marie-Paule Virard, journaliste, qui ont publié à La Découverte en 2005 Le capitalisme est en train de s’autodétruire, M. Bezbakh pense que la crise actuelle signe "une rupture totale de société. Le capitalisme n’est plus en voie de développement, mais en voie d’achèvement. Les puissances occidentales ne peuvent plus faire payer à d’autres pays le coût de la crise, comme ils l’avaient fait en 1929 avec la baisse du prix des matières premières. Nous assistons à un processus d’autodestruction soit du système, soit de son fonctionnement".
Quelle issue face à la crise ?
Un système fondé sur le profit privé et qui ne survit plus qu’à coups de distributions régulières et massives d’argent public est un système fini.
Ce ne sont pas les révolutionnaires qui sont les plus pessimistes sur l’avenir du système : ce sont les grands capitalistes, chefs des trusts, des banques, des bourses, etc...
Ils anticipent de nouvelles chutes des banques et un nouveau krach bancaire et boursier. Ils anticipent un effondrement global des bourses qu’il va falloir fermer. Ils anticipent un arrêt massif de la production américaine. Ils anticipent une récession historique dans le monde. Ils anticipent une cessation de paiement de nombreux Etats dont l’Etat américain. Ils anticipent l’effondrement des marchés émergents ce qui signifiera une crise sociale de grande ampleur dans des pays comme Inde, Chine ou Brésil. Enfin, ils anticipent une crise de confiance dans les monnaies d’une grande ampleur liée aux masses d’argent que les Etats et les banques centrales ont injecté et produit massivement. La Royal Bank of Scotland, Barclays et Fortis ont ainsi envoyé à leurs clients un avis d’alerte systémique.
Les capitalistes estiment que le système n’est pas seulement en crise mais ne fonctionne déjà plus et que cela va bientôt devenir évident aux yeux de tous, provoquant une panique de grande ampleur !
Par le plan Paulson et autres interventions massives des Etats et des banques centrales du monde, les capitalistes ont acheté un peu de temps pour mettre au point leur politique. celle-ci ne peut éviter l’effondrement final mais elle vise à la faire payer aux travailleurs et aux peuples.
Les crises des années 1873 à 1902, crises financières ilées à une suraccumulation du capital, ont mené à la politique de mondialisation, de concentration, de financiarisation, à l’impérialisme et finalement à la première guerre mondiale. La crise de 1929, crise financière liée à une suraccumulation du capital, a mené au fascisme et à la deuxième guerre mondiale. La crise actuelle a les mêmes causes et engendrera les mêmes effets si nous ne mettons pas fin à cet ordre social en renversant les Etats capitalistes. Nous devons être prévenus : l’objectif des luttes actuelles n’est pas la seule défense du niveau de vie des classes laborieuses mais le renversement révolutionnaire du capital par le travail.
Nous sommes entrés dans la crise systémique. Elle n’a encore déroulé que sa première phase et le pire est à venir. Mais il n’y aura pas que des souffrances à venir pour les opprimés : il y aura aussi une occasion à saisir. Car l’ère des crises est aussi l’ère des révolutions, des contre-révolutions et des guerres mondiales. Si c’est une période violente qui vient parce que les classes dirigeantes sont affaiblies, elles n’en sont que plus voraces, corrompues, et elles montrent leur peur par une répression bien plus dure. La civilisation montre son vrai visage : un système d’exploitation barbare et tous les moyens deviennent bons pour des classes dirigeantes complètement déstabilisées : y compris les camps de la mort…
Mais la crise actuelle n’est-elle pas une crise conjoncturelle plutôt qu’une crise révolutionnaire, une crise développant des contradictions permettant la remise en cause la mainmise de la classe dirigeante ? La question signifie un pronostic qui peut paraître hasardeux à tous ceux qui voient la situation comme le développement de difficultés économiques et financières très compliquées et imprédictibles. Mais, dans ce cas, il ne s’agit pas d’une simple crise économique, et encore moins des seules retombées d’un crise financière. C’est une crise qui va nécessairement saper les fondations objectives de la domination de la classe capitaliste sur le monde. Ces conditions objectives sont celles qui vont mener soit à la révolution sociale soit aux dictatures, aux fascismes et à la guerre mondiale. Il s’agit donc de tout autre chose que d’une des crises de régulation, de l’espèce de respiration du capitalisme, comme l’étaient les crises cycliques de l’époque de Marx.
Tout d’abord, il convient de sortir de l’image d’une crise provoquée par les crédits hypothécaires et la titrisation des dettes immobilières ou financières, même s’il est vrai que la crise a pris cette forme. Ce n’en est ni le début ni la cause. Ces opérations hasardeuses et folles n’ont d’ailleurs été que le dernier moyen trouvé pour retarder une crise qui remonte à beaucoup plus loin et remet en cause non pas la finance et sa dérégulation mais la domination mondiale du système capitaliste.
C’est au milieu des années 80 que le système capitaliste s’est retrouvé dans une première impasse grave et a pris une décision historique : changer son mode de domination de la planète. La montée des luttes de la classe ouvrière dans tous les pays piliers de la politique des blocs, à l’ouest comme à l’est (en Pologne comme en Corée du sud, en Yougoslavie comme en Turquie, en Algérie, en Amérique latine et en Afrique du sud) s’est déroulée alors que le capitalisme atteignait un palier dans sa capacité à se développer, à investir, à échanger, en définitive à exploiter les travailleurs. Il y avait à la fois crise sociale, politique et crise économique. Le tournant a été général et profond. C’est la fin de la politique des blocs appelée « chute du mur de Berlin ». C’est le début de la financiarisation massive de l’économie mondiale. C’est le début de la politique dite « mondialisation » qui a ouvert des possibilités aux bourgeoisies des pays pauvres et à celles qui voudraient se construire à l’Est. De là est sorti le monde actuel avec le rôle de la finance et celui des pays émergents. Le capitalisme a aussi engrangé des victoires sociales et politiques contre la classe ouvrière, même si les régimes staliniens n’avaient jamais rien eu à voir avec les intérêts et l’organisation de la classe ouvrière. Les luttes ouvrières ont été dévoyées. Le monde a cru à la nouvelle perspective qui était offerte d’en finir avec les dictatures staliniennes, de développer le globe et la démocratie.
C’est ce choix qui a atteint ses limites en 2000 avec la crise américaine. Sans les avions qui ont percuté, « miraculeusement » pour le grand capital, les tours du world trade center, tous les économistes annonçaient pour les semaines à venir la plus grande crise financière dans ce même centre de la finance américaine et mondiale… Merci Ben Laden devraient dire les capitalistes, si tant est qu’ils n’étaient pour rien dans ce coup fourré, ce qui n’est pas prouvé.
Cette affaire a permis aux USA de prendre le tournant, de mobiliser des moyens financiers invraisemblables dans la production d’armes, de mobiliser les Etats du monde à leurs côtés dans leu soi-disant « guerre contre le terrorisme » qui était d’abord et avant tout une guerre contre une crise économique qui allait entraîner une crise sociale sans précédent aux USA mêmes, dans le plus grand centre du système mondial. Le coup a été écarté et les USA ont pu retarder leur propre perte de quelques années. Les guerres d’Afghanistan et d’Irak n’ont pas eu d’autre but que de permettre de détourner la crise intérieure américaine en mobilisant toute la population au nom de la défense de sa propre sécurité.
Retarder ne voulait dire qu’aggraver les conditions de la crise. La misère a grandit aux USA et les classes dirigeantes américaines n’ont pas trouvé d’autre moyen de dériver le coup une fois de plus que de recourir aux crédits hypothécaires. En même temps, le « Patriot act » soi-disant anti-terroriste permettait d’encadrer les réactions de la population.
Les crises sont des modes de régulation indispensables au système. Aujourd’hui, tous les commentateurs économiques et politiques, adeptes du capitalisme de droite et de gauche, nous bassinet avec la nécessité d’introduire des régulations. La crise actuelle est le produit de dizaines d’année pendant lesquelles l’objectif général du pouvoir capitaliste était d’empêcher la crise mondiale d’éclater.
Quelle est la cause fondamentale de cette crise qui fait qu’elle ne devrait pas éclater selon les dirigeants de l’impérialisme ?
Toutes les années de 1985 à 2000 ont été marquées par la nécessité de produire plus de plus-value par rapport au capital investi. On peut dire que cela a été un succès marquant. Cela a signifié la concentration du grand capital uniquement sur les investissements ultra-rentables. Donc la diminution des possibilités de réinvestissement rentable relativement à l’accroissement du capital total. Du coup, il a fallu développer massivement des investissements factices de substitution très rentables eux aussi de type financiers et boursiers. Mais, on est rentrés là dans une spirale car il fallait que le capital productif permette d’extraire de plus en plus de plus-value totale pour payer les revenus de tous ces capitaux là. Les possibilités d’investissements suffisamment rentables se sont encore réduites et la course à la rentabilité est devenue plus difficile.
D’où la crise actuelle qui est une crise de suraccumulation du capital. De l’argent, la classe capitaliste n’en a jamais eu autant dans toute l’histoire du grand capital. Les capacités productives totales n’ont jamais été aussi grandes quantitativement et qualitativement (technicité, rapidité et efficacité de la production et de l’exploitation de la main d’œuvre).
Mais justement ce succès excède maintenant les capacités d’investissement suffisamment rentables des capitaux.
Les tentatives un peu folles de créer des investissements financiers sur des bases totalement vides provient de la nécessité absolue pour le grand capital, sous peine de mort, que ses fonds s’investissent quelque part. L’affolement impressionnant du grand capital en 2008 n’a pas d’autre base.
Les « solutions » qui ont permis de retarder la crise ont atteint leurs limites et le monde est maintenant gouverné à vue, sans projet, sans issue.
En même temps, la crise prend de l’ampleur avant d’éclater à nouveau dans la sphère financière. La prétention du plan Paulson d’être capable d’absorber les « actifs pourris » a fait long feu. Il y a plus de quarante mille milliards de dollars de titres bidon sans aucune valeur. Ce n’est pas avec 700 milliards de dollars que cela peut être réglé.
La crise n’est pas seulement économique mais sociale et politique, et mondiale dors et déjà. La population américaine a perdu confiance dans sa classe dirigeante et dans ses gouvernants et peut-être même un peu dans le système capitaliste. L’épicentre de la crise, les USA, sont probablement le centre de la déstabilisation des classes dirigeantes. L’élection d’Obama a reflété indirectement ce discrédit même si cela traduit aussi la capacité du système d’incarner le besoin populaire de changement par un homme de la grande finance et de la grande banque. Mais les classes dirigeantes savent bien que cette illusion ne durera pas. Il faudra d’autres « solutions » à cette crise sociale de grande ampleur qui se profile aux USA. Il ne suffira pas non plus d’une guerre au Moyen Orient ni de dire que les USA sont menacés par les Musulmans et le terrorisme. L’ampleur de la crise et des sacrifices exigent des « solutions » plus violentes pour les classes dirigeantes. Les méthodes actuelles ne sont que des moyens de gagner du temps. Il faudra sans doute détourner la crise sociale en crise raciale : contre les noirs. Et aussi, il faudra sans doute engager la guerre mondiale, probablement contre la Russie et la Chine. Même si on n’en est pas encore là, il faut être prévenu. Mais c’est du côté du prolétariat américain qu’il faut aussi regarder car il peut aussi ouvrir un tout autre avenir pour tous les peuples de la planète qui commencent à se révolter.
Dans des pays comme l’Islande, les classes dirigeantes sont conspuées régulièrement massivement dans les rues par des manifestations.
En Chine et en Inde, la crise a à peine frappé que la classe ouvrière est entrée en lutte massivement et fortement. Et elle a été souvent réprimée violemment. Les fermetures d’usines en Chine sont gardées par l’armée. Les manifestations massives ont parfois été attaquées en Chine par des policiers avec chiens. Et ce n’est encore que le début. La crise vient à peine de commencer à frapper. Les « ateliers du monde » n’ont nullement un marché intérieur capable de remplacer les achats des pays capitalistes en crise. La crise va donc être particulièrement violente dans les « pays émergents ». La Chine est une dictature féroce contre la classe ouvrière et elle l’a toujours été. La nouvelle classe ouvrière est jeune, récemment issue de la paysannerie. Elle est combative et elle l’a montré ces dernières années. Elle peut, elle aussi, renouer avec les plus glorieux actes révolutionnaires du passé, notamment avec la Commune de Paris de 1871 et la révolution d’octobre 1917 en Russie. C’est là qu’est l’avenir pour toute l’humanité.

Évolution des emprunts des institutions financières US auprès de la banque fédérale américaine : premier pas vers un effondrement de la confiance financière dans le dollar et dans l’Etat américain ...

"La véritable barrière de la production capitaliste, c’est le capital lui-même"
Karl Marx
"Dans les conditions du XIXè siècle, une crise affectant plus ou moins toutes les unités de capital à l’échelle internationale arrivait sans difficultés excessives à résorber la suraccumulation. Mais au tournant du siècle fut atteint un point à partir duquel les crises et la concurrence ne parvinrent plus à détruire du capital dans des proportions suffisantes pour transformer la structure du capital total dans le sens d’une rentabilité accrue. Le cycle économique, en tant qu’instrument d’accumulation, avait dès lors visiblement fait son temps ; plus exactement, il se métamorphosa en un ‘cycle’ de guerres mondiales. Bien qu’on puisse donner de cette situation une explication politique, elle fut tout autant une conséquence du processus de l’accumulation capitaliste. (...) La reprise de l’accumulation du capital, consécutive à une crise ’strictement’ économique, s’accompagne d’une augmentation généralisée de la production. De même, la guerre a pour effet de ranimer et d’amplifier l’activité économique. Dans un cas comme dans l’autre, le capital refait surface à un moment donné, plus concentré et plus centralisé que jamais. Et cela, en dépit et à cause, tout à la fois, de la destruction de capital."
Paul Mattick
dans"Marx et Keynes"
"Je pense en effet que nous sommes entrés depuis trente ans dans la phase terminale du système capitaliste. Ce qui différencie fondamentalement cette phase de la succession ininterrompue des cycles conjoncturels antérieurs, c’est que le capitalisme ne parvient plus à "faire système", au sens où l’entend le physicien et chimiste Ilya Prigogine (1917-2003) : quand un système, biologique, chimique ou social, dévie trop et trop souvent de sa situation de stabilité, il ne parvient plus à retrouver l’équilibre, et l’on assiste alors à une bifurcation.
La situation devient chaotique, incontrôlable pour les forces qui la dominaient jusqu’alors, et l’on voit émerger une lutte, non plus entre les tenants et les adversaires du système, mais entre tous les acteurs pour déterminer ce qui va le remplacer. Je réserve l’usage du mot "crise" à ce type de période. Eh bien, nous sommes en crise. Le capitalisme touche à sa fin."
Immanuel Wallerstein
Jacques Cotta, sur le site La Sociale : "Le point de départ de la crise financière à laquelle nous assistons n’est donc pas à rechercher, comme on voudrait nous y inviter, dans la finance en soi, mais bien dans l’organisation du système capitaliste qui produit des crises successives au sein de l’économie réelle et qui pousse au développement des marchés financiers pour tenter d’y faire fructifier l’argent qui y est misé. Si aujourd’hui les indices boursiers continuent de faire du yo-yo et si la mine inquiète des spéculateurs remplace l’air réjoui des deux derniers jours, c’est uniquement parce qu’on assiste aux premiers effets de la crise financière qui à son tour agit sur l’économie réelle. De crise financière et crise bancaire, elle affecte les capacités d’emprunt des entreprises comme des particuliers et menace en fin de course l’emploi, les entreprises elles-mêmes et la production [...]. La crise économique profonde du système capitaliste qui traverse le monde trouvera son prolongement sur le terrain social. Dans chaque pays et en France. L’emploi, les salaires, les services publics, la sécurité sociale – dont le déficit de 11 milliards d’euros était abyssal alors que 360 milliards pour les banques sont débloqués en une soirée- les retraites, l’éducation… tout ce qui constitue le ciment de la vie collective va être mis à rude épreuve". Et d’ajouter : "Il est assez cocasse dans ce contexte d’entendre tous les discours et de voir toute l’agitation dont le seul but est la préservation du système capitaliste qui pourtant porte en lui la tempête qui se déchaîne sous nos yeux".

CAPITALISME 2008 : APOCALYPSE NOW

Effondrement des emprunts hypothécaires aux USA

Effondrement des échanges

Effondrement de l’économie américaine
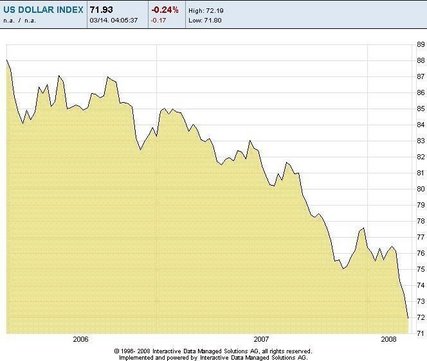
Effondrement du dollar

Effondrement des bourses

Effondrement de la confiance

Thèses du site "Matière et révolution" sur la crise actuelle
Le système capitaliste a hypothéqué son avenir
Le nôtre ne doit pas rester accroché à ce Titanic
1- Il n’y a aucune origine accidentelle à la crise actuelle. Ce n’est pas seulement l’immobilier américain ou les crédits hypothécaires qui sont en cause. C’est l’ensemble de l’économie capitaliste. Pour les capitalistes, loin d’être une surprise, elle est une catastrophe annoncée. C’est seulement pour le grand public, et particulièrement pour les travailleurs, qu’elle est tout ce qu’il y a de plus étonnant : le système qui domine le monde, sans une puissance capable de le renverser, sans une classe sociale qui semble lui contester ce pouvoir, est en train de s’effondrer et de se détruire lui-même.
2- Ce n’est pas une crise conjoncturelle. Ce n’est pas une crise américaine. Ce n’est pas une crise immobilière. Ce n’est pas une crise financière. Ce n’est pas une crise bancaire. Ce n’est pas une crise pétrolière. Ce n’est pas une crise de confiance. Ce n’est pas une crise inflationniste. Ce n’est pas une crise de l’endettement. Ce n’est pas une crise due à une simple récession. Bien sûr, il y a tout cela à la fois mais cela n’explique pas le fondement de la crise. C’est le système capitaliste tout entier qui est en crise. Le terme « systémique » pour caractériser la crise signifie que c’est le fondement, le principe même, du capitalisme qui est mort.
3- C’est l’accumulation du capital qui ne peut plus fonctionner. Et ce pour une raison simple. Le mécanisme d’accumulation du capital a atteint sa limite.
4- Cela signifie que le capitalisme n’a pas subi une maladie, ni un défaut, ni un comportement défaillant de tels ou tels de ses acteurs. Non, le capitalisme meurt parce qu’il a été au bout de ses possibilités. C’est son succès lui-même qui provoque sa fin. Il n’y a pas moyen d’inventer suffisamment d’investissement vu la quantité de capitaux existant dans le monde. Tous les cadeaux des Etats et des banques centrales au capital ne peuvent qu’être des palliatifs d’une durée de plus en plus limitée.
5- Le capital n’est pas simplement de l’argent. De l’argent, il y en a aujourd’hui et il n’y en a même jamais eu autant sur la planète. Mais le capital, c’est de l’argent qui participe à un cycle au cours duquel encore plus de travail va être transformé en argent. L’accumulation du capital est le but même de la société capitaliste. Produire et vendre des marchandises, exploiter les travailleurs, tout cela n’est qu’un moyen. Faire de l’argent, s’enrichir n’est aussi qu’un moyen. Le but même est de transformer cet argent en capital, c’est-à-dire trouver les moyens de l’investir et de lui faire rendre du profit, lequel profit doit lui-même encore être investi.
6- C’est ce mécanisme qui ne fonctionne plus. Il n’est pas grippé. Il n’est pas menacé. Il est mort. Il a été maintenu en survie pendant un temps déjà très long par des mécanismes financiers et eux-mêmes viennent d’atteindre leurs limites. On ne peut pas maintenir le mourant tellement longtemps même en inventant de nouvelles techniques de survie artificielle. Bien entendu, aujourd’hui tout le monde accuse le système financier et ses « folies », mais c’est oublier que ce sont ces prétendues folies, des politiques pratiquées parfaitement consciemment, qui ont permis au système de perdurer au-delà de ses limites.
7- Les guerres locales comme celles d’Irak, celle d’Afghanistan, mais aussi de Yougoslavie et du Timor ont été aussi des moyens de faire durer le système. Mais, là aussi, les limites sont atteintes.
8- Quel moyen aurait le système de se redresser vraiment ? Celui de détruire une très grande partie des richesses et des marchandises accumulées. Il ne lui suffit pas de détruire les richesses fictives de la finance. Il lui faut, pour repartir, détruire une partie de la planète comme il l’a déjà fait, dans des circonstances semblables, lors de deux guerres mondiales.
9- De là découle l’alternative pour les classes ouvrières et les peuples. Entre le Capital et le Travail, il y a maintenant une question de vie ou de mort. Même si la classe ouvrière ne souhaite pas consciemment se préparer au renversement définitif du système et à la fondation d’une société reposant sur la satisfaction des besoins collectifs des peuples de la planète, c’est le capitalisme lui-même qui va la contraindre à choisir. Et il ne suffira pas, bien entendu, d’attendre la chute du capitalisme actuel car ce qui viendra ensuite peut tout à fait être bien pire : une nouvelle barbarie, qu’elle soit capitaliste ou pas. Cet effondrement économique, qui sera suivi d’un effondrement social et politique, moral même, ne signifie pas,, bien entendu, que la classe dirigeante et ses Etats vont céder la place d’eux-mêmes à une société au service des intérêts collectifs de la population.
Si la société humaine doit bâtir un nouvel avenir, elle devra le faire consciemment. Les prétendues "réformes du système" et autres "régulations" ne sont que de la poudre aux yeux. Aucune mesure ne peut ni sauver le système ni sauver les populations. Plus tôt les travailleurs, les jeunes, les peuples se convaincront qu’il va falloir en finir radicalement avec les Etats qui ne défendent que le système, moins ils en paieront les conséquences.
10- Les mécanismes politiques et sociaux de domination sont désormais dépassés. On va voir du nouveau mais pas dans le sens du progrès. Les « démocraties » occidentales vont montrer toute leur barbarie aux populations qui y sont le moins préparées : celles de leurs propres pays. Les dictatures, les fascismes vont revenir au goût du jour.
11- Il est urgent de préparer l’avant-garde aux situations à venir. Il n’y a rien de plus urgent que de comprendre la crise actuelle et ses conséquences et de les faire comprendre autour de nous. Ce qui est à l’ordre du jour n’est pas seulement de se défendre contre des attaques. C’est de se défendre contre une attaque idéologique de grande ampleur. Les gouvernants vont tâcher de donner leur propre interprétation des événements pour nous convaincre qu’eux seuls peuvent faire revenir l’époque passée. Ils mentent. Elle ne peut pas revenir. Ils vont chercher ainsi à nous empêcher de nous organiser entre nous pour comprendre, discuter et répondre aux situations. La crise de confiance des peuples dans le système est dangereuse si les opprimés, si les peuples se mettent à s’organiser, et déjà à se réunir pour confronter les points de vue, pour donner leurs avis sur la signification de ce qui se passe et sur les moyens d’y faire face.
12- Ce que souhaite la classe dirigeante, c’est que chacun se retrouve face à ses peurs, face aux problèmes matériels touchant sa vie, celle de sa famille, et se demande seulement quel dirigeant bourgeois va pouvoir le sauver. Des sauveurs suprêmes, des Hitler ou des chefs civils ou militaires dictatoriaux prétendant tenir la solution, on va en voir défiler. La première des tromperies qui va se présenter à nous sera celle des réformistes de tous poils qui auront quantité de prétendues solutions pour sauver à la fois le système et la population. Le seul effet de leurs discours sera de démobiliser les opprimés et d’éviter tout risque révolutionnaire aux exploiteurs afin de leur permettre de préparer leurs vraies solutions violentes : dictatures et guerres. D’avance il faut se préparer à n’avoir confiance qu’en nous-mêmes.
13- Au lieu de se protéger, ce qui ne sera pas possible, il faut saisir l’occasion. Le capitalisme est atteint dans ses fondements. Profitons-en pour en finir avec ce système d’exploitation. Nous sommes des millions de fois plus nombreux que les exploiteurs et bien plus forts que le système si nous en sommes conscients. La fin du capitalisme ne sera une catastrophe et un recul massif que si nous nous contentons de nous défendre, catégorie par catégorie, pays par pays, groupe social par groupe social. Cela peut être le prélude d’une avancée historique de l’humanité si nous décidons d’en finir avec l’esclavage salarié.

La crise : ordre ou désordre ?
C’est la crise.
Tout le monde le sait. Tout le monde le voit. Mais on a du mal à la comprendre.
Des crises, il y en a eu de nombreuses. Il y a presque toujours une crise, à un niveau ou à un autre dans cette société. De quel type de crise s’agit-il ?
Mais qu’est-ce que la crise ?
Pour tout le monde, la crise, c’est le désordre.
En fait, la crise, c’est un trop grand ordre !
Quand le système fonctionne, c’est le désordre des marchés qui changent sans cesse, dans un sens puis dans l’autre, sans être prévisibles à long terme, qui donne sa structure au système. En période de crise, tous les capitalistes jouent à la baisse en même temps sur tous les marchés. Il y a des petites phases de hausse où tout monte, puis tout redescend encore plus bas. Les rythmes qui continuent à exister ne sont plus du même type. Ce sont des rythmes trop ordonnés. Ce type de rythmes montre que le système est atteint.
De telles crises systémiques peuvent avoir lieu dans un système social aussi bien que dans un système biologique. Quand les rythmes du cœur sont trop réguliers, quand le message du cerveau est trop ordonné, c’est la maladie grave.
Que veulent les capitalistes ?
Le système est menacé. On le sait puisqu’on n’arrête pas de nous dire qu’il faut toujours prendre des mesures plus radicales et des mesures impressionnantes pour sauver le système. Mais par qui le système est-il menacé ? Par les marchés, nous dit-on. C’est-à-dire par les possesseurs de capitaux !
Qu’est-ce qui leur prend, à ces capitalistes, d’agir de façon à détruire le système qui était le leur ?
Ils ne font rien de spécial. Ils ne font que fonctionner comme d’habitude. Investir et retirer leurs capitaux en fonction d’anticipations des résultats à venir. Mais toutes leurs anticipations leur disent que cela va s’effondrement. Et ils ne peuvent qu’y répondre en accroissant la chute …
Ils sont en train de détruire le système en fonctionnant comme ils le faisaient avant et pourtant, maintenant, cela a comme résultat de démolir tout l’édifice.
Chaque jour, leurs désinvestissements signifient : cette société va s’effondrer.
D’où leur vient cet affolement ? Il vient du fait que les investissements rentables ont tous été épuisés et qu’ils ne peuvent plus trouver des achats dont ils estiment qu’ils vont rapporter du profit.
Ce sont les grands capitalistes qui sont les artisans de la crise de leur propre système.
Est-ce quelque chose de si étonnant ? Pas du tout. Dans les crises systémiques, c’est toujours le cas.
Quand un système atteint ses limites ?
La société féodale s’est écroulée à partir de 1789 du fait d’une crise provoquée en 1788 par la noblesse. La société pharaonique égyptienne s’est écroulée en 2350 avant J.-C du fait d’une crise au sein de la classe dirigeante qui a relancé le féodalisme au détriment du pouvoir central. Les révolutions qui ont suivi ces crises au sein de la classe dirigeante n’effacent pas le fait qu’il a fallu les conditions objective (les classes dirigeantes ne peuvent plus gouverner comme avant) pour que les classes opprimées se posent le problème d’intervenir et fassent la révolution (ou, parfois, que la classe dirigeante fasse une contre-révolution ou une guerre préventive). Les guerres mondiales, les crises mondiales n’ont pas été provoquées par les opprimées. Les révolutions sociales n’ont été que le produit des crises de la domination de classe, et non le contraire.
C’est le capitalisme qui sonne la fin de son système. Bien entendu, cela n’enlève nullement aux opprimés, aux travailleurs, leur propre rôle pour bâtir une autre société.
La fin d’un système, qu’est-ce que cela signifie ?
Ce terme, qui est utilisé dans nos thèses, a fait réagir de nombreux lecteurs.
Pourquoi parler de mort du système alors que ce sont les travailleurs qui peuvent, et eux seuls, en finir définitivement avec la société de classe, son exploitation et son oppression ?
Il y a une différence entre une crise conjoncturelle, espèce de respiration un peu violente du système à de multiples échelles (crise d’une entreprise, d’un secteur, d’un pays, d’une région) et une crise systémique.
Quand le fonctionnement n’est maintenu que par des intubations artificielles (à coups de centaines de milliards de dollars ou d’euros) qui permettent tout juste d’éviter la mort immédiate, c’est que le patient (Sharon par exemple) est très gravement malade. S’il s’agit de lui envoyer des doses phénoménales de sérum, de le nourrir et de le faire respirer artificiellement, on peut imaginer qu’il sortira à un moment du coma. Mais à condition que tous les hommes autour de lui ne soient pas dans le même cas. L’économie du Japon peut passer par un trou. Ou celle de l’Asie. Quand c’est l’économie mondiale c’est comme si tous les médecins autour de Sharon étaient eux aussi dans le coma ! Là, c’est fini.
Cela change considérablement la perspective. La nécessité de la révolution sociale ne provient plus seulement de la révolte contre le système mais du fait que le bateau coule. Qu’on le veuille ou pas, il va falloir construire autre chose.
Il ne va pas s’enfoncer en une fois. Par contre, quand il commencera à sombrer, cela ira vite. Il faut s’y préparer.
Et ceux qui défendront qu’on peut encore prendre des mesures pour vivre sous son égide seront des gens dangereux.
"Vous avez aimé la crise des subprimes, vous adorerez la crise des LBO (LBO = titrisation des dettes des sociétés d’achats par endettement avec effet de levier)"
Le "Canard Enchaîné" le 22 septembre 2008
« Un cycle de croissance de dix ans s’achève. Au-delà du retournement cyclique, il est clair que l’on touche aujourd’hui aux limites d’un modèle de développement »
L’économiste Jean-Hervé Lorenzi
Cité par « Le Figaro » du 7 juillet 2008
Précisons que ce qui est menacé dans la crise actuelle, c’est tout simplement le capitalisme ! Voilà ce que ne voudrons certainement pas entendre tous ceux pour qui l’existence éternelle de l’empire actuel ne doit même pas être questionnée.
En effet, ce qui est mis en cause, c’est tout simplement le niveau trop élevé de la capitalisation mondiale par rapport aux capacités d’absorption des marchés. Or, c’est le mécanisme fondamental qui est ainsi atteint : l’augmentation du capital.
L’hypertrophie de la finance apparaît comme la cause de la crise mais elle en est surtout la conséquence, le seul moyen qu’a trouvé le système pour perdurer.
UN GRAPHIQUE OU L’ON VOIT QUE LES CHOCS PÉTROLIERS, LES ATTENTATS ET LES GUERRES NE SONT PAS LES CAUSES MAIS LES RÉPONSES A LA CRISE QUI ONT PERMIS DE LA RETARDER JUSQU’À LA CRISE ACTUELLE

article du site Matière et révolution
Pour nous écrire, cliquez sur Répondre à cet article
Dans le journal économique Világgazdaság, le Prix Nobel d’économie Joseph E. Stiglitz réfléchit à la crise économique mondiale. "Le monde sombre actuellement dans une crise financière qui sera selon les prévisions la pire depuis un quart de siècle, et peut être même depuis la crise économique mondiale de 1929. Cette crise est à bien des égards ’Made in America’. … Les pays qui avaient déjà avant la crise un gros déficit de la balance commerciale et un endettement élevé, souffriront plus que les autres. Ceux qui n’ont pas encore complètement libéralisé leurs marchés financiers et leurs marchés de capitaux, comme la Chine, pourront s’estimer heureux de ne pas avoir cédé à la pression du ministère des Finances américain. … Les vieilles institutions ont reconnu la nécessité de réforme, mais elles ont avancé à un rythme de tortue. Elles n’ont rien entrepris pour empêcher la crise actuelle. Se pose en outre la question de l’efficacité des réactions de ces institutions. … Après la crise économique mondiale, le monde a eu besoin de 15 ans et d’une guerre mondiale(...)"
Crise de 2008 : le mur de l’argent qui tombe, et … après
La crise économique mondiale de 2008 n’est pas un épisode un peu douloureux mais qui sera passé assez vite avec quelques difficultés au passage. C’est un tournant historique pour l’humanité. Nous ne faisons que de commencer à en mesurer l’importance et les conséquences. C’est la chute du mur de Wall Street qui marque le début du 21ème siècle comme la « chute du mur de Berlin » a marqué la fin du 20ème siècle. L’effondrement de la finance, de la bourse, de la banque et de l’économie est rapide, massif et impressionnant. Il signe la fin d’un règne même si ce qui va suivre est loin d’être établi ni même dessiné. Si la fin du stalinisme, qui avait toujours été un allié fidèle de l’impérialisme contre les peuples et les classes ouvrières, a été présenté comme une grande victoire du capitalisme sur le communisme, il n’en est nullement résulté un monde plus juste, plus libre ni moins guerrier. Et maintenant, c’est le capitalisme lui-même qui déclenche son propre effondrement sans être victime d’un quelconque ennemi : ni du terrorisme, ni du nationalisme, ni même du communisme. Ce ne sont pas les luttes des travailleurs qui sont en train d’abattre les murailles de Chine du capitalisme, c’est son propre fonctionnement qui le mène irrémédiablement à sa perte ! Le grand capital est amené à avoir un comportement qui est un poison mortel pour le système capitaliste lui-même. Il ne s’agit pas seulement de dérives des financiers. Tous les possesseurs de capitaux, en recherchant seulement leur profit individuel comme ils l’ont toujours fait, sont amenés à détruire le système à son cœur lui-même : l’investissement. Même si les Etats prétendent aujourd’hui investir des sommes colossales pour pallier aux investissements des capitalistes, ils ne peuvent pas relancer la machine. Les possesseurs de capitaux ne sont pas des philanthropes, ce n’est pas leur rôle. Si un investissement est rentable, ils se jettent dessus. S’il ne l’est pas ou s’il risque de ne plus l’être, impossible de convaincre les possesseurs de capitaux de s’y lancer. Or, aujourd’hui, les capitalistes de tous les pays sont unanimes et condamnent à mort la société capitaliste : pas assez rentable. C’est cela qui les a amené à retirer progressivement leurs capitaux des investissements productifs pour les concentrer sur la sphère financière qui permet des profits fabuleux et rapides. Ils s’en moquent, eux, que les profits financiers ne puissent pas produire de marchandises, qu’ils ne permettent pas de créer réellement de plus valus. Ils s’en moquent parce que les profits qui rentrent dans leurs caisses, eux, ne sont pas fictifs ! Toutes les banques, toutes les assurances, tous les trusts, et même toutes les collectivités locales ont été aspirés par cette possibilité de gagner de sommes considérables au jeu de loto des titres pourris, comme les subprimes. Peu importe que la base de ces titres n’était plus des sociétés florissantes mais des dettes, seulement des dettes. Peu leur importait que cet amoncellement de dettes ne faisait que grandir. Peu leur importe que leur crise ait englouti des milliers de milliards, des sommes des centaines de fois supérieures à ce qu’il faudrait pour en finir avec la faim, le manque d’eau, l’absence de santé et la misère dans le monde entier. Peu leur importe que cet amoncellement de dettes gagne maintenant les Etats qui comptent aller jusqu’au bout : au-delà de vider la caisse des Etats et des banques centrales, jusqu’à hypothéquer le sort des générations futures. Peu leur importe de fermer massivement les entreprises, de licencier massivement les travailleurs. Comme peu leur a importé de jeter à la rue massivement les propriétaires de maisons endettés aux USA. Le discours des gouvernants est clair : il faut sauver le système capitaliste, rien que cela ! Voilà donc un système qui ne serait pas si éternel que cela … Peu leur importe des hommes politiques qui dissertent sur la réforme du système. Ils ne peuvent ni ne veulent rien réformer à leur appétit de profits. C’est la base même du système qui est en cause et cela, personne ne peut le réformer. Le capitalisme, il faut l’accepter, avec ses conséquences les pires comme les guerres d’Irak et d’Afghanistan, avec les massacres comme celui de la France au Rwanda, ou il faut le renverser. Les travailleurs n’ont pas, pour le moment, décidé de passer à l’offensive, mais toute l’Histoire prouve que, lorsque la crise sociale est là, la classe ouvrière est capable de prendre en mains les rênes de la société. Ils n’ont jamais encore été jusqu’au bout de cette révolution sociale, mais une fois encore le problème est posé à cause de la crise provoquée par la classe dirigeante.
On nous a menti : la chute du mur de Berlin et la mondialisation qui a suivi, accompagnée à une financiarisation de la société et à une mise en coupe réglée accrue de la planète, n’était peut-être pas tant que cela dû à une victoire du capitalisme mais à une fuite en avant du même type que la mondialisation qui avait suivi la crise systémique de 1873 puis mené à la guerre mondiale de 1914-1918, cette horrible boucherie qui a ensanglanté l’Europe et que l’on vient de commémorer sans être capable de nous expliquer ce qui l’a causé. La crise a également entraîné des révolutions sociales comme celle de 1917 en Russie, ou des contre-révolutions fascistes comme celle de Mussolini en Italie en 1922. Puis la crise systémique de 1929 a mené à de nouvelles horreurs : fascismes en Allemagne et en Espagne et, à nouveau, guerre mondiale, pour finir par une entente entre stalinisme et bureaucratie qui a relativement stabilisé la planète sur la base d’une exploitation éhontée des peuples. C’est cette stabilité qui a été ébranlée au milieu des années 1980 par les travailleurs : ceux de Pologne, de Yougoslavie, de Chine, du côté du bloc dit de « l’Est », et ceux de Corée du sud, d’Afrique du sud, de Turquie, du Brésil, d’Argentine, du côté du bloc de l’Ouest. C’est l’une des raisons de la fin de la politique des blocs, politique usée jusqu’à la corde. Russie, Chine ou pays de l’Est ont rejoint le monde capitaliste, mais ce monde vient de montrer que l’ouverture des marchés n’a pas suffi à relancer la machine. Elle est décidément arrivée à ses limites. Elle ne peut plus compter sur de nouvelles avancées. Dans le cadre de ce système, il n’y a plus à attendre que des horreurs, et bien pires que ce que nous avons connu auparavant. Non, les travailleurs et les peuples n’ont pas à attendre que le ciel leur tombe sur la tête. Si le capitalisme n’a plus d’avenir, cela ne veut pas dire que l’humanité est foutue. Elle est tout à fait capable de bâtir une autre société, fondée sur les besoins de ses membres et non plus sur le profit de quelques sociétés. 2008 sera certainement la date d’un tournant historique, mais c’est à nous, c’est aux peuples aujourd’hui opprimés et exploités, d’en donner la signification historique : un grand pas en avant ou un grand pas en arrière pour le genre humain !
Qu’est-ce qu’une crise capitaliste ?
Des dizaines, puis des centaines de milliards de dollars engouffrés dans les trous des banques, des assurances et des bourses, et le début d’une forte récession, la crise actuelle entraîne de nombreuses inquiétudes et d’encore plus nombreuses questions, le plus souvent sans réponse. Et pour cause ! Le système capitaliste, nous le connaissons bien et même nous ne connaissons que lui. Et pourtant, nous ne le connaissons pas ! C’est la crise elle-même qui révèle à la plupart d’entre nous des fonctionnements totalement ignorés.
Le plus souvent, nous réfléchissons au système capitaliste comme s’il s’agissait d’un mode rationnel de fonctionnement. Ou, au moins, d’un mécanisme qui devrait être rationnel. Nous le pensons comme un système dirigé par des êtres humains en vue de buts humains. Ce n’est pourtant pas le cas. Nous y voyons "une société de consommation" ou encore "un marché". Là encore, il s’agit d’un contre-sens. La société marchande est depuis longtemps morte et le capitalisme n’est pas essentiellement achat et vente.
La situation actuelle de crise est l’objet des mêmes contre-sens. Certains y voient une nouvelle crise de l’immobilier. D’autres une crise des ressources énergétiques. D’autres encore, une crise du système de régulation des marchés financiers. Toutes ces interprétations visent à cacher le véritable problème qui touche les fondements mêmes du système, et du système capitaliste et pas seulement du "système financier". En fait, il n’existe pas un système financier qui serait séparé du système capitaliste.
Le capitalisme n’est pas en crise parce qu’il manquerait d’argent, qu’il manquerait de richesses à pomper, qu’il manquerait de travailleurs à exploiter, ni parce que les exploités en ont assez mais, simplement, parce qu’il manque de perspectives pour ses investissements. Les besoins à satisfaire existent toujours (les besoins matériels insatisfaits croissent considérablement) , mais les satisfaire ne serait plus assez rentable. La course au profit se heurte donc à un mur, à une limite. Les processus multiples pour contourner cette limite (financiers notamment) n’ont fait qu’aggraver le niveau de la crise puisqu’ils ont accru dans des proportions phénoménales le capital total sans accroitre dans la même proportion les investissements possibles. Ces méthodes financières, monétaires, bancaires, etc... ne peuvent être que des palliatifs momentanés et ne peuvent pas résoudre le problème. le système est de plus en plus bloqué. Sa maladie : trop d’argent pour en faire du capital participant à des cycles économiques.
Il convient de distinguer les multiples crises de fonctionnement, indispensables au capitalisme ou crises de conjoncture des crises systémiques qui menacent de mort le système lui-même.
Il serait erroné de voir dans la crise actuelle une simple crise conjoncturelle. Les éléments dont on dispose à l’heure actuelle poussent plutôt à y voir une crise systémique, c’est-à-dire une véritable limite du système qui le remet fondamentalement en question.
Bien sûr, il y a diverses crises au sein de la situation actuelle :
– une crise immobilière doublée d’une crise spéculative
– une crise boursière
– une crise bancaire
– une récession économique
– une crise américaine liée aux divers déficits de l’impérialisme US
– une crise générale de la domination impérialiste
etc...
Mais tout cela ne s’additionne pas. Il n’y a en fait qu’une seule crise qui a longtemps été retardée par l’impérialisme US essentiellemnt grâce à ce que l’on a appelé la "mondialisation".
Il y a peu de chance que les USA parviennent encore à retarder l’explosion. les trémoussements des chefs d’Etat et des dirigeants financiers de la planète ne font que souligner leur grande inquiétude.
L’une des dernières mesures après quelques faillites retentissantes aux USA, en Grande Bretagne ou en Espagne, avait été la décision de Bush d’annoncer une limitation du droit de spéculer sur les sociétés dont les noms suivent. Sous-entendu, ces sociétés sont pleines de trous, vont bientôt faire faillite et le système financier va les attaquer. Ce sont :
BNP Paribas, Bank of America, Barclays Citigroup, Crédit Suisse, Daiwa Securities, Deutsche Bank, Allianz, Goldman Sachs, Royal Bank, HSBC Holding, JP Morgan Chase, Lehman Brothers, Merril Lynch, Mizuko Financial Group, Morgan Stanley, UBS, freddie Mac et Fannie Mae. On a vu que cela n’a rien empêché et nombre de ces établissements sont soit en faillite, soit rachetés à bas prix, soit nationalisés. Les autres lle seront bientôt ! La raison : officiellement quarante mille milliards de dollars de trous !!!
Mais, là encore, ce n’est que la partie immergée de l’iceberg de la crise. Sur le fond, le capitalisme lui-même répond : "no future" (pas d’avenir)
Ce ne sont pas les peuples, c’est le système qui n’y croit plus et ne voit plus d’échappatoire.
Laisser exploser le tout va de plus en plus lui paraître la meilleure solution pour parvenir au même résultat : faire payer aux peuples les frais de la crise, assainir en détruisant, pour - beaucoup plus tard et après quelles guerres ? - repartir sur des bases plus saines si tout n’est pas détruit d’ici là !
Pour les travailleurs et les peuples, la situation est neuve : il faut préparer un autre avenir débarrassé du capitalisme.

La crise économique du capitalisme vient de repartir de plus belle en janvier 2008. Dans la foulée de la crise des subprimes qui avait enflammé l’immobilier et la finance aux USA, en Angleterre et en Espagne. Elle se double maintenant d’une crise des liquidités, d’une chute des bourses et d’une crise des banques. La crise américaine y rajoute la menace d’une récession mondiale de grande ampleur. Des banques américaines et européennes sont menacées. Les banques françaises commencent à reconnaître l’existence de fonds douteux. La BNP avait commencé dès le début de la crise. La Société Générale reconnaît indirectement la même chose avec un perte de plusieurs milliards d’euros. Et ce n’est qu’un début ....
La finance, se détournant des bourses et du dollar, joue sur les monnaies, sur le prix du pétrole, sur les prix des produits alimentaires. Il en découle un effondrement du niveau de vie dans les pays les plus pauvres et jusque dans les pays riches. L’inflation se rajoute à la récession, rendant quasi impossible toute politique pour retarder ou éviter l’aggravation de la crise.
Comment comprendre le sens de cette crise économique ? Il s’agit bel et bien d’une crise systémique, c’est-à-dire d’une catastrophe générale qui prend sa source dans les mécanismes fondamentaux du système à l’échelle mondiale et les menace tous. Le capitalisme s’autodétruit, même s’il ne mène pas lui-même à une solution. Sans chercher à expliquer leurs crises. les classes dirigeantes prétendent éviter la crise. En fait, elles recherchent d’abord à éviter que leur système d’exploitation et de mise en coupe réglée du monde en soit affecté et, en second, que leurs propres capitaux accumulés, n’en subissent des conséquences. les peuples, comme les deux guerres mondiales l’ont montré, ne seront pas nécessairement épargnés, tant que les travailleurs épargneront le système capitaliste.
Pour le moment, s’il faut insister sur un point, c’est de ne faire aucune confiance aux déclarations des gouvernants, des banquiers et des industriels. Tous prétendront vouloir nous sauver et mettre sur pied plan sur plan dans ce but. Ils ne feront que nous enfoncer dans la misère et le chômage soi-disant pour nous sauver... Aucune confiance dans les banques pour y laisser nos économies. Aucune confiance aux industriels pour "sauver nos emplois". Aucune confiance aux gouvernants pour "protéger le pays de la crise" comme ils disent. Travailleurs, n’ayons confiance qu’en nous-mêmes, qu’en notre force, qu’en notre mobilisation, qu’en notre organisation ! Unissons-nous par delà les frontières. Ne croyons à aucun discours nationaliste présentant un autre peuple, un autre pays, un seul chef d’Etat, comme le seul responsable. Ils le sont tous ! La crise économique, eux tous les transformerons en occasion de nouvelles rapines, de nouvelles fortunes faciles. Transformons-la en une occasion de nous libérer définitivement de leur système d’exploitation ! Les travailleurs ont une société bien plus humaine, plus constructive, bien plus utile à l’ensemble des hommes à offrir. La nouvelle crise du capitalisme doit sonner l’avènement du socialisme !
Il ne s’agit pas là d’un simple vœu mais d’une nécessité. la crise pose en effet une question au monde, comme les crises mondiales systémiques précédentes.
En effet, les précédentes crises systémiques ont produit guerres mondiales, dictatures, fascismes mais aussi révolutions prolétariennes. Il y a une alternative : socialisme ou barbarie qui se pose à terme au monde.
En tout cas, la crise sonne le glas des conceptions réformistes. Celles-ci n’ont été capables que de négocier comment se faire exploiter. Aujourd’hui même ces sacrifices sont insuffisants pour le capitalisme qui est menacé par sa propre crise.
Dors et déjà les peuples les plus pauvres sont plongés dans la misère : l’Egypte redécouvre la famine et l’Afrique connaît de nouvelles émeutes. Ce n’est qu’un début. Le pire effondrent sera celui de la petite et de la moyenne bourgeoisie des pays riches : quand on est un peu au dessus, on tombe de plus haut ! Et cela signifie la fin de la démocratie capitaliste car sa propre base disparait. Pour ceux qui veulent réfléchir pour préparer l’avenir, la révolution mondiale n’est plus une lointaine perspective mais à une perspective à préparer dès maintenant.
Mais, d’abord, il convient de comprendre comment cette crise exprime des limites du système capitaliste incapable de proposer des investissements à une part croissante des capitaux. Là est la source de la part croissante de capitaux dédiés à la spéculation. Là est également la source de la crise actuelle. Cela signifie que l’on ne peut pas dire que la spéculation a causé la crise. C’est le capitalisme lui-même qui est en crise et pas seulement le système financier.
Il ne peut pas y avoir d’amélioration, de "régulation" du système. la crise touche aux fondement même de la société du profit capitaliste, société qui ne peut pas être réformée mais seulement renversée.
Le capitalisme en crise ne peut entraîner le monde que dans des catastrophes de grande ampleur. C’est le seul moyen pour lui de se relancer. Il doit (presque) tout détruire pour repartir sur de nouvelles bases. Par conséquent, loin d’être sorti rapidement de sa crise actuelle, le système mondial de domination va entraîner tous les peuples du monde dans le cauchemar : récession, effondrement des banques, misère, dictatures, guerres et guerre mondiale...
La seule réponse n’est pas régulation ni intervention de l’Etat mais intervention de la classe ouvrière et des peuples : REVOLUTION et la seule alternative : LE POUVOIR AUX TRAVAILLEURS visant à la suppression du mode d’exploitation capitaliste.

ENTRETIEN AVEC IMMANUEL WALLERSTEIN
"Je pense que nous sommes entrés depuis trente ans dans la phase terminale du système capitaliste. Ce qui différencie fondamentalement cette phase de la succession ininterrompue des cycles conjoncturels antérieurs, c’est que le capitalisme ne parvient plus à "faire système", au sens où l’entend le physicien et chimiste Ilya Prigogine (1917-2003) : quand un système, biologique, chimique ou social, dévie trop et trop souvent de sa situation de stabilité, il ne parvient plus à retrouver l’équilibre, et l’on assiste alors à une bifurcation.
La situation devient chaotique, incontrôlable pour les forces qui la dominaient jusqu’alors, et l’on voit émerger une lutte, non plus entre les tenants et les adversaires du système, mais entre tous les acteurs pour déterminer ce qui va le remplacer. Je réserve l’usage du mot "crise" à ce type de période. Eh bien, nous sommes en crise. Le capitalisme touche à sa fin.
Pourquoi ne s’agirait-il pas plutôt d’une nouvelle mutation du capitalisme, qui a déjà connu, après tout, le passage du capitalisme marchand au capitalisme industriel, puis du capitalisme industriel au capitalisme financier ?
Le capitalisme est omnivore, il capte le profit là où il est le plus important à un moment donné ; il ne se contente pas de petits profits marginaux ; au contraire, il les maximise en constituant des monopoles - il a encore essayé de le faire dernièrement dans les biotechnologies et les technologies de l’information. Mais je pense que les possibilités d’accumulation réelle du système ont atteint leurs limites. Le capitalisme, depuis sa naissance dans la seconde moitié du XVIe siècle, se nourrit du différentiel de richesse entre un centre, où convergent les profits, et des périphéries (pas forcément géographiques) de plus en plus appauvries.
A cet égard, le rattrapage économique de l’Asie de l’Est, de l’Inde, de l’Amérique latine, constitue un défi insurmontable pour "l’économie-monde" créée par l’Occident, qui ne parvient plus à contrôler les coûts de l’accumulation. Les trois courbes mondiales des prix de la main-d’oeuvre, des matières premières et des impôts sont partout en forte hausse depuis des décennies. La courte période néolibérale qui est en train de s’achever n’a inversé que provisoirement la tendance : à la fin des années 1990, ces coûts étaient certes moins élevés qu’en 1970, mais ils étaient bien plus importants qu’en 1945. En fait, la dernière période d’accumulation réelle - les "trente glorieuses" - n’a été possible que parce que les Etats keynésiens ont mis leurs forces au service du capital. Mais, là encore, la limite a été atteinte !
Y a-t-il des précédents à la phase actuelle, telle que vous la décrivez ?
Il y en a eu beaucoup dans l’histoire de l’humanité, contrairement à ce que renvoie la représentation, forgée au milieu du XIXe siècle, d’un progrès continu et inévitable, y compris dans sa version marxiste. Je préfère me cantonner à la thèse de la possibilité du progrès, et non à son inéluctabilité. Certes, le capitalisme est le système qui a su produire, de façon extraordinaire et remarquable, le plus de biens et de richesses. Mais il faut aussi regarder la somme des pertes - pour l’environnement, pour les sociétés - qu’il a engendrées. Le seul bien, c’est celui qui permet d’obtenir pour le plus grand nombre une vie rationnelle et intelligente.
Cela dit, la crise la plus récente similaire à celle d’aujourd’hui est l’effondrement du système féodal en Europe, entre les milieux du XVe et du XVIe siècle, et son remplacement par le système capitaliste. Cette période, qui culmine avec les guerres de religion, voit s’effondrer l’emprise des autorités royales, seigneuriales et religieuses sur les plus riches communautés paysannes et sur les villes. C’est là que se construisent, par tâtonnements successifs et de façon inconsciente, des solutions inattendues dont le succès finira par "faire système" en s’étendant peu à peu, sous la forme du capitalisme."

LU SUR LE NET DE LA FINANCE :
Apocalypse now
Alors que le dollar bat des records de faiblesse face à l’euro, les analyses de certains observateurs sont de plus en plus sombres. Dans une présentation à la Commission de Finances de la Chambre des représentants, le professeur Nouriel Roubini a décrit un tableau apocalyptique de la situation.
Nouriel Roubini est professeur d’économie à la Stern School of Business de la New York University. C’est un homme respecté qui a eu le bonheur de prévoir les difficultés économiques américaines, notamment l’éclatement de la bulle immobilière et ses conséquences sur la sphère financière américaine.
Mardi, il a été invité par la Commission des Finances de la Chambre des Représentants à donner son avis sur la situation actuelle. Il a décrit en douze points la possibilité d’un effondrement systémique du système financier. En premier lieu, Nouriel Roubini remarque que la récession de l’immobilier est la pire de l’histoire américaine. Il envisage une baisse des prix des logements comprise entre 20% et 30% par rapport au niveau précédent l’éclatement de la bulle. Cela se traduirait par une évaporation de 4000 à 6000 milliards de dollars du patrimoine des ménages américains.
Dans l’hypothèse d’une baisse de 30% de la valeur des logements, 10 millions de ménages seraient dans une situation de "negative equity" : ils devraient à leur banque plus, voire beaucoup plus, que la valeur de leur maison. D’où des perspectives de faillites personnelles et de faillites de promoteurs immobiliers.
Deuxième point, l’estimation des pertes liées au crédit "subprime" sont comprises entre 250 et 300 millions de dollars. Toutefois, il y a un effet de contagion sur l’ensemble des crédits hypothécaires, surtout sur la partie titrisation. Comme ce marché est fermé, les banques ne peuvent pas distribuer du crédit, même aux bons emprunteurs. La crise n’est pas limitée aux Etats-Unis : elle s’est répandue mondialement.
Troisième point, la récession va provoquer des problèmes de défaut sur d’autres formes de crédit à la consommation : carte de crédit, prêt automobile, prêt étudiant, tous étant titrisés. Selon le sondage organisé par la FED auprès des directeurs de crédit des établissements bancaires, la raréfaction du crédit ("credit crunch") se répand sur les prêts à l’habitat, puis sur les crédits à la consommation, puis sur les grandes banques et enfin sur les petits établissements (même s’ils sont bien gérés).
Quatrième point, on ne peut pas exactement connaître les pertes que devront supporter les rehausseurs de crédit ("Monoline"). Elles sont certainement supérieures au package de recapitalisation (10 à 15 milliards de dollars) que les régulateurs tentent de mettre sur pied. D’après Nouriel Roubini, le rating AAA accordé aux "Monoline" n’est pas justifié. Cela peut se traduire par de nouvelles provisions bancaires de 150 milliards de dollars.
Cinquième point, l’immobilier commercial et d’entreprise va lui aussi s’effondrer. Les pratiques bancaires dans ce domaine étaient aussi insouciantes et dangereuses que dans l’immobilier résidentiel. Bientôt, plus personne ne va vouloir construire de surfaces commerciales, de bureaux et de magasins dans des villes devenues fantômes.
Sixième point, Nouriel Roubini n’écarte pas la faillite d’une grande banque américaine exposée au risque immobilier (déjà 200 préteurs "subprime" ont fait faillite). Et de craindre une évolution similaire à Northern Rock, en Grande Bretagne, avec une panique des déposants. La FED devra donc confirmer que la doctrine "too big to fail", (trop grosse pour faire faillite) sera respectée. Et de noter que Countrywide a reçu pour 55 milliards de dollars de financement de la Federal Home Loan Bank (FHLB), un organisme semi-public.
Septième point, les pertes des banques liées aux activités de financement des LBO ("leveraged buyout") sont déjà conséquentes et augmentent. Les établissements bancaires portent sur leur bilan des prêts qui, au mieux, valent 90% de leur valeur nominale et souvent moins. Les LBO réalisés avec un endettement représentant sept à huit fois le cash flow de l’entreprise pourraient être les premiers touchés.
Huitième point, avec la récession, le taux de défaut des entreprises (celles qui ne peuvent plus honorer leurs dettes) va augmenter. De 1971 à 2007, le taux moyen était de 3,8% mais entre 2006 et 2007, il est tombé à 0,6% (sans doute un effet de l’abondance de crédit pendant ces deux années). Or, généralement, le taux de défaut remonte à 10% pendant une récession classique. Aujourd’hui, Nouriel Roubini envisage un taux nettement supérieur avec un impact important sur le marché des dérivés de crédit (CDS, Credit Default Swap). L’encours des CDS est proche de 50.000 milliards de dollars ; les pertes potentielles seraient de 20 à 250 milliards de dollars.
Neuvième point, le système financier fantôme ("shadow financial system"), composé par les établissements ou organismes non-bancaires (donc non réglementés par la FED) va avoir des problèmes. Son principe ayant été d’emprunter des ressources à court terme pour financer des emplois (investissements) à long terme, il est maintenant acculé au mur. A la différence des banques, il n’a pas accès aux facilités de financement de la Réserve Fédérale, notamment le guichet de l’escompte. Son sauvetage en sera d’autant plus difficile et Nouriel Roubini n’écarte pas la faillite de plusieurs Hedge Funds, de plusieurs Sicav Monétaires (dites dynamiques), voire d’une ou deux banques d’affaires.
Dixième point, les marchés boursiers mondiaux vont s’ajuster aux perspectives d’une sévère récession américaine. Et de prévoir un marché baissier persistant (baisse de 28% de l’indice Standard and Poor’s des 500 valeurs), la faillite de quelques Hedge Funds et une contagion globale sur les autres places boursières.
Onzième point, la raréfaction du crédit va s’amplifier et aura des conséquences néfastes sur la liquidité de plusieurs marchés financiers. Cela se traduira par une vive remontée du prix du risque (manque de confiance entre contrepartie, hausse des spreads interbancaires).
Douzième point, un cercle vicieux de pertes, réduction de capital, contraction du crédit, ventes forcées d’actifs provoquera d’autres phénomènes de contraction du crédit. Et de craindre que les prix des actifs financiers descendront à un niveau inférieur à leur valeur fondamentale. Le catalyseur d’un tel événement ? La baisse de rating des assureurs "monoline" et l’effondrement des bourses.
Nouriel Roubini cite les estimations de Goldman Sachs pour qui une perte globale de 200 milliards de dollars des institutions financières se traduit par une contraction de crédit de 2000 milliards de dollars. La recapitalisation des banques par les fonds souverains (80 milliards de dollars) ne va pas endiguer le phénomène.
Une fois ce tableau dressé, Nouriel Roubini émet au moins une note optimiste. Il remarque que la FED, qui n’avait pas pris conscience de l’ampleur des problèmes, est maintenant alerte. Cependant, il doute qu’elle puisse endiguer le tsunami qui se prépare. Et il conclu par une dernière crainte : les ménages qui sont très endettés et qui subissent le phénomène de "negative equity) pourraient décider d’abandonner leur logement et le remboursement de leurs emprunts. Combien sont concernés ? 10 à 15 millions selon Nouriel Roubini. Ce qui fait froid dans le dos.
lPascal Boulard

Sur la crise de 1929
Le secrétaire d’Etat américain Mellon face à la crise de 1929, cité Herbert Hoover, dans ses « Mémoires » : « Il suffit de liquider les ouvriers, les stocks, les agriculteurs et l’immobilier. »
Extraits de « Histoire économique et sociale du monde » de P. Léon :
« La grande crise du monde capitaliste
« La crise débuta en octobre 1929 aux Etats-Unis par une crise boursière ; elle prit rapidement un caractère mondial, elle fut longue et atteignit son paroxysme lorsque la production tomba au plus bas : 1931 en Grande-Bretagne, 1933 aux Etats-Unis et 1935 en France. Les différents rouages de la vie économique furent successivement touchés. Ainsi, le krach de Wall Street engendra une nouvelle chute des prix de 1929 à 1932, dans laquelle vinrent d’inscrire en mai 1931 une crise française et, à partir de septembre de la même année, une crise monétaire. Malgré la diversité de ses manifestations, loin de constituer une série de crises qui venaient s’ajouter accidentellement les uns aux autres, le cataclysme était dû à un enchaînement de causes.(…) Une nouvelle chute des prix, dont le centre fut encore une fois les Etats-Unis, eut lieu dans le second semestre de l’année 1937 et la production mondiale ne se releva vraiment que grâce à la course aux armements pendant l’année 1938 (…) La crise du capitalisme eut de multiples aspects qui sont indissociables. Par commodité, les répercussions sociales et les luttes qu’elle provoqua sont traitées à part : le danger d’un tel parti pris assimilable à l’économisme est de faire tout dépendre de la politique économique (…)
La flambée sur le cours des actions à la Bourse de New York avait commencé en 1927-1928 : l’indice des valeurs industrielles indique un doublement des cours en moins de deux ans (début 1928 : 191 ; décembre 1928 : 300 ; septembre 1929 : 381). Bien que cette poussée n’eût rien d’exceptionnel dans l’histoire de la Bourse, elle expliquait assez bien la fièvre du public. Les transactions en 1929 portaient en moyenne sur 42 millions de titres par jour, avec parfois des montées en flèche à 82 millions comme en mars 1929. La hausse du nombre de transactions ne présentait aucun danger en soi. Le fait que certaines actions passaient entre plusieurs mains en peu de temps dénotait pourtant le caractère spéculatif de ces mouvements. Le nombre des Américains qui jouaient à la Bourse était autour de 1,5 millions sur 122 millions d’habitants, mais en réalité le marché se cristallisait autour de quelques milliers de spéculateurs parmi lesquels Samuel Insull, Charles Mitchell de la National City Bank et Albert Wiggins de la Chase Bank. Comment expliquer tout d’abord l’abondance des titres mis sur le marché ? Principalement par la transformation rapide des structures sociales de l’entreprise – de la firme familiale à la société anonyme - et par l’habitude prise par les grandes affaires de prévoir à l’avance, au moyen d’augmentations anticipées du capital, leurs projets d’investissements à long terme. A quoi il faut ajouter la multiplication caractéristique de l’époque des sociétés d’investissement qui n’étaient que des pyramides financières fondées sur l’achat, en principe, de bons portefeuilles afin d’offrir à l’épargnant la possibilité de jouer sans risques. D’où provenait en second lieu la flambée des cours ? (…) Dans l’atmosphère de prospérité générale qui régnait et surtout par suite du manque d’informations des épargnants, un mouvement excessif d’anticipation à la hausse avait eu lieu, surtout dans les secteurs à la traîne et dans les affaires risquées. La spéculation n’avait plus aucun lien avec le montant des dividendes distribués, elle se fondait sur la hausse des cours des actions et prenait manifestement un caractère de plus en plus psychologique. (…) L’un des phénomènes les plus caractéristiques de cet emballement de Wall Street fut la forte croissance des prêts aux courtiers. Ils doublèrent de fin août 1926 à fin novembre 1928 et augmentèrent encore d’un tiers à partir de cette date jusqu’à fin septembre 1929. (…) L’édifice du crédit boursier était donc tout aussi fragile que celui du crédit international ; de plus, il pompait les liquidités du monde. Le gouvernement fédéral était d’ailleurs convaincu du danger de la situation ; cependant il hésita longtemps avant d’intervenir, le seul moyen qu’il eût à sa disposition pour réduire la masse monétaire en circulation étant de relever le taux d’escompte. Or, une telle manipulation ne pouvait qu’accentuer la récession économique qui était apparue fortement dans le bâtiment, voire l’automobile. Le 6 août, ce taux fut finalement porté à 6%. (…) Il n’y eut pour le moment point de résultat sur la Bourse. La crise débuta le 23 octobre et le jeudi 24, le fameux jeudi noir, ce fut la panique : 13 millions de titres furent cédés, 16,5 millions d’actions furent encore liquidées le 29. Malgré l’intervention d’un syndicat de banquiers (Morgan, Mitchell, Wiggin, …) qui avança un milliard de dollars pour couvrir des prêts à vue, malgré celle du Système Fédéral qui fournit également des fonds – ce qui était contraire à la loi – et qui abaissa le taux d’escompte à 5 puis 4,5%, le krach dura 22 jours. Ce fut le plus long de l’histoire. (…)
Comment expliquer le retournement du cycle boursier ? Il faut noter d’abord que les difficultés des affaires et de l’emploi avaient commencé bien avant, de part et d’autre de l’Atlantique. Le resserrement de la production, des prix et de l’emploi en Europe – sauf la France – datait du premier trimestre de 1929 (déjà 1,9 millions de chômeurs en Allemagne). Aux Etats-Unis, la construction des villas de luxe s’était fortement ralentie dès le printemps, la production des automobiles avait atteint le chiffre record de 622.000 en mars, avant de retomber à 416.000 dès septembre. Dans le cas américain, les trois indicateurs précités qui cernent l’activité économique changèrent de direction à partir de juin. (…) La crise boursière ne fut qu’un « maillon de la chaîne » qui désagrégea les économies occidentales. Certes, à la fin de l’année 1929 et au début de 1930, des liquidités réapparurent à la suite du renversement des politiques d’escompte des banques centrales. Il était trop tard. En raison de la contraction du crédit au moment du krach, le phénomène de déflation des prix avait atteint un nouveau palier qui fut longtemps irréversible. A son tour, la déflation, cette fois générale, provoqua un réflexe de retrait des fonds et de thésaurisation d’une tout autre ampleur qui fit éclater au grand jour la crise économique. La spéculation boursière avait donc masqué pendant un temps la contradiction entre l’existence d’une suraccumulation mondiale de capitaux et une économie qui végétait faute de débouchés. Le krach fut moins dû à la prise de conscience de l’inanité d’une telle spéculation qu’aux déséquilibres supplémentaires que la Bourse créait. »
« Un processus de nivellement comparable en grandeur et en soudaineté à celui auquel Lénine avait présidé une décennie auparavant. »
John Kenneth Galbraith dans « La crise économique de 1929 »

Extraits de « Enquête sur le capitalisme dit triomphant » (1995)
de Claude Bitot
La crise des années 70 comparée à celle de 1929
« La crise actuelle est-elle la répétition de celle de 1929 ? » de Robert Boyer
article pour le n°8206 de la revue du Cepremap (centre d’études prospectives d’économie) :
« Lors des années vingt, la forte croissance de l’économie repose sur un boom de l’accumulation portant de façon privilégiée sur la section des moyens de production. Quant à la croissance de l’emploi, elle est dans sa quasi-totalité dépendante du succès de l’accumulation puisqu’elle est uniquement le fait de la section 1. La crise de 1929 apparaît donc comme une crise de suraccumulation dans la section 1, ce qui explique que, de 1929 à 1938, la chute de l’accumulation, différentiellement plus marquée dans la section 1, impose le retour à une relative cohérence des deux sections mais au prix d’une contraction cumulative de la production et de l’emploi. A l’opposé, à partir de la fin des années cinquante, l’accumulation se porte simultanément sur les deux sections, signe d’une forme nouvelle d’articulation entre les conditions de production – tout particulièrement dans la section 2, initialement retardataire par rapport aux normes américaines – et les conditions de vie des salariés. (…) Dans la crise actuelle – tout comme de 1930 à 1938 – la montée du chômage ne dérive pas de désajustements conjoncturels, mais bien de l’arrivée aux limites d’un régime d’accumulation – lui-même conséquence d’un ensemble de formes structurelles ou institutionnelles originales. (…)
Le mode de croissance de l’après seconde guerre (…) a buté aux Etats-Unis depuis le milieu des années soixante (…) sur les limites de l’approfondissement de la division sociale et technique du travail, hypothéquant la poursuite des gains de productivité élevés, base sur laquelle repose la stabilité du mode de croissance due en particulier à la complémentarité salaire-profit d’une part, consommation et investissement de l’autre. (…) Aux Etats-Unis dans le milieu des années soixante se manifeste un problème majeur de productivité industrielle, que ces difficultés naissent du caractère de plus en plus coûteux du développement des forces productives ou des luttes des travailleurs (…). Si la crise de 1929 était marquée par l’incompatibilité entre un taux de profit – trop haut – et des perspectives de réalisation – insuffisantes du fait même du niveau du taux de profit -, la dynamique à l’œuvre après 1945 se manifeste au contraire par une très grande régularité de la croissance qui conserve jusqu’en 1973 un niveau élevé. (…) C’est l’ensemble des formes institutionnelles, d’un régime d’accumulation intensive centrée sur la consommation de masse et d’une régulation dite « monopoliste » qui entre en crise au début des années soixante-dix. (…) Apparemment, les années 1930-1931 d’une part, 1974-1975 de l’autre, font apparaître une étonnante similitude quant à la contraction de la production industrielle et du PIB (environ – 11% pour la première, – 4% pour la seconde). De la même façon, l’investissement se contracte massivement bien qu’à un rythme moindre en 1975 (- 7% contre – 15%). De fait, au-delà de ces similitudes, on enregistre deux différences fondamentales :
– Après la chute de la production pendant quatre trimestres, le mouvement se renverse au milieu de l’année 1975 alors que la dépression ne cesse de s’approfondir jusqu’en 1932 ;
– Au cours des deux années sous revue, une différence fondamentale tient à l’opposition entre une déflation qui va s’approfondissant (respectivement
–2,8% et -7,5% de chute des prix à la consommation en 1931 puis 1932) et la poursuite de l’inflation à un rythme élevé peu affecté par l’ampleur de la récession (10,9% et 9,6% par an en 1975 et 1976). (…)
Si la récession (des années soixante-dix) s’arrête au bout de quatre trimestres, c’est pour l’essentiel du fait de la poursuite d’une forte croissance de la consommation des ménages (+ 4,2% par an) alors qu’au contraire elle avait chuté de 1930 à 1931 (-5,1%). Ainsi s’explique qu’après une première année de réduction de l’investissement, ce dernier se remette à croître légèrement, du fait des pressions qu’exerce la demande finale sur les capacités de production d’abord dans le secteur des moyens de consommation et par extension dans celui des moyens de production. Enfin, la reprise de la croissance des exportations au milieu de l’année 1975 s’oppose à l’effondrement qui survient de 1931 à 1932, lui-même conséquence de la montée du protectionnisme et de la dislocation des relations internationales qui marquent les années trente. (…) Le contraste entre l’effondrement de la consommation dans les années trente (son taux annuel de variation passe de 2,3% à – 3,8% après 1930) et la très légère décélération après 1974 (de + 4,9% à + 3,6% par an) est frappant (…)
La crise actuelle trouve son origine dans le divorce entre un niveau de taux de profit trop bas et la poursuite d’une croissance des débouchés de moyens de consommation, impulsée par le rapport salarial, dans un premier temps tout au moins. Dans un second temps, le blocage de l’accumulation a pour conséquence de réduire le dynamisme de la consommation, crise liée à l’insuffisance de la rentabilité et récession dérivant de la contraction de la demande effective cumulant leurs effets. Tout le problème est alors celui du relèvement du taux de profit. (…)
Il est clair que la complexité de ce réseau de contradictions marque l’arrivée aux limites du mode de développement lui-même et non pas un « dérèglement passager ». (…) Quelles qu’en soient les causes (suraccumulation liée à la montée de la composition technique ou à une croissance « disproportionnée », conséquence de la spéculation financière, …), les crises trouvent leur origine dans une baisse du profit qui, contractant l’accumulation, déclenche une chute de la production, donc de l’emploi. La reprise intervient lorsque les faillites industrielles et bancaires et le chômage induisent un relèvement du profit suffisant pour enclencher une nouvelle phase d’expansion, initiée par la restauration des bases de l’accumulation (abondance des réserves de main d’œuvre, salaires bas, possibilités de crédit … donc haut niveau du taux de profit). (…)
Une crise cyclique correspond à un épisode de chute de la production, d’effondrement de l’accumulation, de faillites industrielles et bancaires selon un mouvement assurant la reconstitution quasi automatique des bases d’une reprise de la croissance à formes institutionnelles globalement inchangées. A l’opposé, une crise structurelle, ou grande crise, désigne un épisode au cours duquel la dynamique de la reproduction économique entre en contradictions avec les formes sociales et institutionnelles sur la base desquelles elle opère. »

Chronologie des crises capitalistes
1780 : naissance du capitalisme anglais
1817 : récession
1825 : crise de surproduction industrielle, première crise capitaliste
1836-39 : récession
1846-48 : crise de sous-production agricole
1857 : première crise industrielle et financière (Etats-Unis, Grande Bretagne puis France)
1866 : récession
1873 : baisse de la production de biens d’équipement, hausse du prix du charbon, baisse du rendement des chemins de fer et de la sidérurgie puis crise boursière et bancaire (Allemagne, Autriche, Etats-Unis)
1882 : faillite bancaire en France puis spéculations boursières sur fond de chute agricole française et anglaise face aux USA
1890-93 : croissance économique zéro. Faillite à la bourse de Londres sur fond de baisse de la production européenne et américaine. En 1891, crise économique et financière en Italie. Aux USA, grandes grèves et trois millions de chômeurs. En 1893, crise aux USA, en Argentine et en Australie.
1900 : récession
1907 : crise économique et sociale au Japon
1913 : essoufflement des industries de la première industrialisation, endettement, inflation et contraction des échanges
1920-1923 : crise mondiale d’après-guerre puis crise monétaire en Allemagne
1929-1932 : crise boursière US suivie d’une récession mondiale
1949 : petite récession
1953 : récession américaine
1970-75 : crise du dollar, puis crise pétrolière et récession
1979 : second choc pétrolier
1980-82 : récession
1982 : Mexique en cessation de paiements
1987 : krach boursier US dû au déficit de la balance commerciale américaine
1990 : krach boursier de Tokyo
1994-95 : crise mexicaine
1997-98 : crise financière « asiatique » et russe : crise des monnaies et fuite des capitaux
2001 : krach du Nasdaq et scandales financiers américains, crises argentine, turque et brésilienne
2007 : crise des organismes de prêt au logement US et crise boursière

Où en est l’économie mondiale ?
Le capitalisme vole-t-il vers de nouveaux sommets au travers des crises ou est-il en train de rouler à toute vitesse vers un mur, celui qui limite le développement capitaliste ? On nous le présente volant de succès en succès après l’absorption de l’URSS, des pays de l’Est, et des divers pays ex-(soi disant) socialistes, conquérant la planète par sa « mondialisation » par ses technologies nouvelles, développant des secteurs nouveaux, multipliant ses profits et ses investissements. Mais il est, au contraire, en recul, limité dans son développement par des contradictions de plus en plus menaçantes, au bord du gouffre, de la catastrophe mondiale, du krach boursier, du fait de l’impossibilité de développer les investissements productifs à la même échelle que les profits fabuleux accroissent le grand capital, la multiplication des capitaux financiers menaçant de déstabiliser le monde en transformant la prochaine récession américaine en une vaste crise de confiance s’attaquant à toutes les institutions financières comme en 1929.
Faut-il croire les capitalistes lorsqu’ils annoncent des profits futurs toujours plus importants ou les croire lorsqu’ils plaident pour l’austérité au nom de la crise économique ou simplement de la nécessité de rester prudents ? Faut-il les croire quand ils annoncent un règne capitaliste sans nuage ou quand ils affirment que des gros dangers pèsent sur un système de plus en plus géant, de plus en plus mondialisé et déséquilibré par l’endettement et l’hypertrophie des marchés financiers ? Le capitalisme est-il en phase ascendante et dans sa période la plus longue de prospérité ou, au contraire, bute-t-il de manière de plus en plus incontournable sur des limites qu’il est incapable de repousser ? Sur quoi se fonde la croissance des profits ? Uniquement sur l’accroissement de la misère et de la surexploitation ou sur celle-ci et du coup sur une restriction du marché qui ne peut mener que dans le mur ou sur une réorganisation qui réduit les coûts avec une redistribution des richesses au sein des possédants, une concentration de la richesse essentielle en un plus petit nombre de mains ?
Y répondre n’est pas simple car il faut bien savoir ce que l’on veut se donner comme critères et ce que ce que l’on veut mesurer avec ceux-ci. Il importe de mesurer l’expansion et la croissance capitaliste et de mesurer l’importance des crises. Rappelons d’abord que les deux sont loin de s’opposer sauf dans un certain nombre de discours mensongers. Si le monde a connu récemment de nombreuses crises (américaine en 1971, américaine en 1987, japonaise en 1990, mexicaine en 1994 avant la « crise des pays émergents » de 1997, les seules phases de récession économique globale de toute cette période sont 1974-76 et 1980-82. Est-ce en pleine expansion que le capitalisme a besoin de nombreuses crises cycliques, pour résoudre au passage ses contradictions, dans le cas de 2007 et de la crise boursière initiée par les pertes du secteur financier lié à la bulle spéculative de l’immobilier américain ? Ces dernières années, les crises cycliques n’ont pas manqué et l’on sort tout juste de la crise financière de 1997 qui a touché un grand nombre de pays de l’Asie, de la Russie et des pays de l’est à l’Amérique latine soit une grande part des pays sous-développés. Il est donc évident que des crises, notamment financières, sont toujours nécessaires au fonctionnement capitaliste. Cependant cela ne répond pas entièrement au problème. Certaines crises type 1929 proviennent des limites infranchissables d’un capitalisme bloqué plutôt que de crises de croissance ? Est-ce qu’après la crise, le capitalisme est reparti de plus belle, produisant de nouveaux profits ?
Ainsi, dans sa phase ascendante de départ le capitalisme avait-il des crises cycliques tous les 9-10 ans qui étaient des crises de croissance. Mais ces crises ne sont pas du même type que la crise de 1929 qui n’est pas le sommet de la crise, car la reprise n’a pas eu lieu ensuite. Après la crise de 1929, il a fallu attendre le milieu des années 40, c’est-à-dire qu’il a fallu la guerre et la destruction d’une grande partie du monde, pour que le capitalisme reparte. Quant à la crise de 1929, elle n’était pas une crise de croissance. C’est au sommet de sa prospérité que le capitalisme a connu la crise de 1929 et non du fait d’un recul économique, d’une récession, d’une baisse des investissements. Cela signifie que la crise systémique se produit quand le capitalisme atteint ses limites. C’est cette limite qui impose la suraccumulation, c’est-à-dire le fait que les capitaux issus des profits soient trop nombreux par rapport aux possibilités d’investissements productifs rentables.
« La Crise économique de 1929 »
de John Kenneth Galbraith
« Une année mémorable
Pendant une décennie, toutes les fois que les Américains ont été affligés de doutes sur la pérennité de leur état de prospérité habituel, ils se sont demandé : « Est-ce que c’est 1929 qui va recommencer ? » Et, même après un quart de siècle, c’est toujours une année à la personnalité politique singulière. (....) Il serait bon de savoir si, en fait, nous connaîtrons un jour un autre 1929. Toutefois, la tâche beaucoup moins prétentieuse de ce livre - la seule que les sciences sociales permettent dans leur état présent – est de dire ce qui est arrivé en 1929, ainsi qu’immédiatement avant et après. (…) La catastrophe du marché financier à l’automne 1929 a longtemps été tenue pour un événement un peu secondaire. (…) C’est travestir la réalité. Il y a une unité essentielle dans les phénomènes économiques : aucune muraille de Chine ne sépare le fiduciaire du réel. (…) Les années Vingt furent en Amérique une bonne époque. La production et l’emploi étaient élevés et s’élevaient encore. Les salaires ne montaient guère mais les prix restaient stables. (….) Enfin, le capitalisme américain se trouvait sans aucun doute dans une phase active. Entre 1925 et 1929, le nombre d’établissements industriels s’était accru de 183.900 à 206.700 ; la valeur de leur production industrielle s’était élevée de 60,8 milliards de dollars à 68 milliards de dollars (Federal Reserve Bulletin décembre 1928). (...) En 1926, 4.301.000 automobiles étaient fabriquées. Trois ans plus tard, en 1929, la production s’était accrue de plus d’un million et avait atteint 5.358.000, un chiffre qui se compare très honorablement avec les 5.700.000 immatriculations de nouvelles voitures au cours de l’opulente année 1953. Les bénéfices des affaires s’élevaient rapidement et c’était une époque favorable pour faire des affaires. (...) Le boom de la Floride contenait tous les éléments de la classique affaire véreuse en matière de spéculation. (...) En Floride, la terre fut partagée en lotissements à construire et vendue pour un règlement comptant de 10%. (...) Les acquéreurs ne comptaient pas y vivre (...) La réalité était que ces biens douteux gagnaient en valeur tous les jours et pouvaient être vendus avec un solide bénéfice, quinze jours après. C’est un aspect du climat spéculatif : au fur et à mesure que le temps passe, la tendance diminue de voir au delà du simple fait de la valeur croissante et jusqu’aux raisons qui l’expliquent. Et il n’y a pas de raison pour qu’on le fasse tant que le lot des gens qui achètent avec l’espoir de vendre avec profit continue à augmenter à un rythme suffisamment rapide pour maintenir la montée des prix. (...) Cependant, au printemps 1926, la source de nouveaux acquéreurs, si essentielle pour que les prix continuent de monter, commença à tarir. Comme 1928 et 1929 devaient le montrer, l’élan donné par une bonne hausse ne se dissipe pas en un instant. (...) Le boom de la Floride fut la première indication de l’atmosphère des années Vingt et de cette conviction que Dieu voulait que la classe moyenne américaine s’enrichit. Mais que cette atmosphère ait survécu à l’effondrement de l’Affaire de la Floride est encore plus remarquable. (...) Tandis que le boom de la Floride s’effondrait, la foi des Américains en un enrichissement rapide et sans effort dans le domaine financier devenait tous les jours plus évidente. (...) Dans les derniers mois de 1924, le prix des valeurs commença à monter et l’augmentation se prolongea et se développa tout au long de 1925. (...) Au cours de 1926, il y eut une sorte de recul. (...) Cependant, en avril, le marché se consolida et reprit son avance. Un autre léger recul eut lieu en octobre, immédiatement après que l’ouragan ait balayé les vestiges de l’Affaire de la Floride ; mais à nouveau la reprise fut rapide. (...) En 1927, la hausse commença pour de bon. Jour après jour et mois après mois, le prix des actions monta. (...) L’année 1927 est historique d’un autre point de vue dans l’histoire de la Bourse. Selon une thèse souvent acceptée, ce fut cette année-là que furent semées les graines du désastre final. (...) Le taux d’escompte fut ramené de 4 à 3,5%. (...) Les fonds que la Banque fédérale libéra furent, soit investis dans des valeurs courantes, soit (et c’est plus important) rendus disponibles pour aider à financer l’achat de valeurs courantes par d’autres. Ainsi munis d’argent, les gens se précipitèrent à la Bourse. (...) Cependant, l’explication admet visiblement que les gens spéculeront toujours s’ils peuvent trouver l’argent nécessaire pour le faire. C’est bien loin d’être le cas. (...) Tandis que les mois d’hiver 1928 furent plutôt calmes, par la suite le marché commença à monter, non à pas lents et réguliers, mais par de grands bonds extraordinaires. Parfois, il descendait aussi de la même façon, mais seulement pour se ressaisir et monter encore. (...) L’histoire des marchés en concurrence dépeint la bourse comme le plus impersonnel des marchés. (...) Cependant, il y a des « gros » qui font monter et descendre les valeurs. Comme le boom se développait, les gros devenaient de plus en plus omnipotents dans l’opinion populaire – ou, tout au moins, chez les spéculateurs. En mars, les « gros » décidèrent de faire monter le marché. (...) En juin 1928, le marché recula (...) Le 12 juin où les pertes furent particulièrement lourdes, fut une date décisive. (...) Un journal new-yorkais commença ainsi son récit de événements de la journée : « Le marché en hausse de Wall Street s’est effondré hier avec une détonation qui a été entendue dans le monde entier. » (...) En juillet, il y eut un petit gain et, en août, une forte montée. (...) Andrew Mellon (financier, industriel et secrétaire d’Etat au Trésor) déclara : « Il n’y a pas de raison d’être inquiet. La marée haute de la prospérité continuera. » (...) Monsieur Mellon participait au rituel dont on estime dans notre société qu’il possède un grand pouvoir pour influencer le cours du cycle des affaires. (...) Le 16 novembre, une nouvelle vague d’achats atteignit le marché. (...) Le 20 novembre fut une autre journée énorme. (...) Décembre ne fut pas si bon. (....) Cependant, le marché se stabilisa et se redressa. Pendant toute l’année 1928, l’indice des cours du Times gagna 86 points, de 245 à 331. (....) Comme on l’a noté, à certains moments dans la croissance du boom, tous les aspects de la propriété des biens n’existent plus à côté de la perspective d’une augmentation prochaine des prix. Les revenus des biens, ou le plaisir qu’ils procurent, ou même leur valeur à long terme deviennent alors des réalités académiques. (....) Dans toutes les grandes orgies spéculatives, des moyens sont apparus pour permettre au spéculateur de se concentrer sur ses affaires. Dans l’affaire de la Floride, le trafic portait sur les « options ». Ce n’est pas la terre elle-même qui était vendue, mais le droit d’en acheter à un prix donné. Ce droit d’achat – qui s’obtenait par un premier versement de 10% du prix d’achat – pouvait être vendu. Il conférait ainsi au spéculateur le bénéfice entier de l’augmentation de la valeur. Après que le prix du lotissement avait monté, le spéculateur pouvait revendre l’option au prix qu’il l’avait payée, plus le total intégré de l’augmentation. (...) Le marché financier a aussi son plan pour concentrer les énergies spéculatives du spéculateur et, comme on peut s’y attendre, il raffine de manière substantielle, les principes fondamentaux du marché des valeurs foncières. (...) Les banques fournissent des fonds aux courtiers, les courtiers aux clients, et la garantie retourne aux banques dans un circuit sans heurts et presque automatique. (...) Le volume de prêts des courtiers – de prêts garantis par des valeurs achetées sur marge – est un bon indice du volume de la spéculation. Ainsi mesurée, la masse de la spéculation s’accroissait très vite en 1928. Au début des années Vingt, le volume des prêts de courtiers – à cause de leur liquidité, on les appelle prêts au jour le jour ou prêts de marché à court terme – variait d’un milliard à un milliard et demi de dollars. Vers le début de 1926, ils avaient monté à deux milliards et demi de dollars (...) Au cours de 1927, il y eut une autre augmentation d’environ un milliard de dollars et à la fin de l’année, ils avaient atteint 3.480.780.000 dollars. C’est une somme incroyable mais ce n’était qu’un début. (...) Les prêts des courtiers atteignirent 4 milliards le 1er juin 1928, 5 milliards le 1er novembre et à la fin de l’année, ils approchaient les 6 milliards. Jamais on ne vit semblable chose auparavant. (...) Wall Street pouvait même fournir un emploi plus profitable pour le capital d’exploitation d’une compagnie que par une production accrue. Quelques firmes prirent cette décision : au lieu d’essayer de produire des marchandises avec les tracas et les inconvénients multiples que cela comportait, elles se limitèrent à financer la spéculation. (...) C’était simplement qu’une hausse terrible progressait sur le marché des valeurs et, comme toutes les hausses, elle devait finir un jour. (...) Quand les prix s’arrêteraient de monter – quand le flot des gens qui achetaient en vue d’une augmentation se serait épuisé – alors la propriété sur marge n’aurait plus de sens et tout le monde voudrait vendre. Le marché ne s’étalerait pas et s’effondrerait brutalement. (...) Le vrai choix était entre un effondrement immédiat et délibérément organisé et un désastre plus grave ultérieurement. (...) Les hommes qui avaient la responsabilité de ces choix inéluctables étaient le Président des Etats-Unis, le secrétaire d’Etat au Trésor, le Conseil de la Banque Fédérale à Washington, le Gouverneur et les directeurs de la Banque Fédérale à New York. (...) Les instruments de régulation étaient en fait largement inutiles. (...) La banque fédérale doit avoir des valeurs à vendre. (...) Vers la fin de 1928, l’inventaire des valeurs d’Etat de la Banque Fédérale s’élevait seulement à 627 millions de dollars. (...) L’autre instrument de la politique de la Banque Centrale était le taux de réescompte. C’est le taux auquel les banques commerciales empruntent aux banques fédérales (...) Seule une augmentation brutale aurait rendu sans profit à une banque d’emprunter à la Banque d’Etat afin de prêter, directement ou non, au marché financier. (...) En fait, cela augmenterait seulement les taux pour les emprunteurs des affaires normales. (...) Cependant, la hausse continuait. En janvier, l’indice des cours des actions industrielles du Times gagna 30 points de plus que dans la joyeuse période (précédente). Les prêts des courtiers montèrent au niveau formidable de 260 millions de dollars. (...) Le 2 février, le Conseil de la Banque Fédérale publia un communiqué de presse : « (....) Le Conseil a une grave responsabilité toutes les fois que la preuve est faite que les banques associées maintiennent des prêts pour la spéculation sur des valeurs, avec l’aide du crédit de la Réserve Fédérale . » (...) La Banque d’Angleterre éleva son taux bancaire de 4,5% à 5,5% dans un effort pour diminuer le flux des fonds britanniques vers le nouveau monde. Le résultat fut une rupture brutale du marché. Le 7 février, en une journée à 7 millions d’actions, le cours du Times tomba de douze points, avec une nouvelle chute le jour suivant. Vers la fin du mois de mars, des nouvelles inquiétantes parvinrent à Wall Street. (...) Le lundi 25 mars, la tension devint insupportable. (...) Les gens commencèrent à vendre. (...) Le jour suivant, le lundi 26 mars, (...) davanatge de gens encore décidèrent de vendre et ils vendirent en masse. Nombre stupéfiant, 8.246.740 actions changèrent de main à la Bourse de New York, bien au delà de tout record antérieur. (...) Chaque nouvelle cotation était loin au dessous de la précédente. (...) Le matin du 26 mars, le taux sur l’argent à court terme atteignit 20%, son niveau le plus élevé lors du boom de 1929. (...) Le directeur de la Banque Fédérale Charles E. Mitchell déclara à la presse : « Nous estimons que nous avons une obligation qui l’emporte sur tout avertissement de la Banque Fédérale, c’est d’écarter toute crise grave sur le marché de l’argent. » La National City Bank, annonça-t-il, prêterait l’argent nécessaire pour empêcher la liquidation. (...) Vers la fin des échanges, le 26, les taux avaient baissé et le marché s’était repris. (...) Le jour suivant, la National City Bank régularisa son engagement envers la hausse ; elle annonça qu’elle garantissait des taux raisonnables d’intérêt, en mettant 25 millions de dollars sur le marché à court terme. (...) C’était également l’époque des fusions et chaque nouveau regroupement exigeait, inévitablement, des capitaux nouveaux et une nouvelle émission de titres pour la financer. (...) L’exemple le plus remarquable d’architecture spéculative de la fin des années Vingt fut la société ou le trust d’investissement. Elle ne créait pas de nouvelles entreprises et n’élargissait pas les anciennes ; elle s’arrangeait simplement pour que des gens puissent posséder les titres de vieilles sociétés par l’entremise de nouvelles. (...) Au cours de 1929, on estime que 186 sociétés d’investissement furent organisées : dans les premiers mois de 1929, elles se créèrent au rythme d’à peu près une par jour et, au total, 265 naquirent tout au long de l’année. (…) Vers l’automne 1929, la totalité des avoirs des sociétés d’investissement était estimée supérieure à huit milliards de dollars. Ils avaient augmenté d’environ onze fois depuis le début de 1927. (…) Dans presque tous les cas elle (la société d’investissement) était créée par une autre société et, vers 1929, toutes sortes d’affaires différentes faisaient naître des sociétés de placements. (…) La firme fondatrice, ou ses promoteurs, recevaient des allocations, d’actions ou de garanties qui leur donnaient le droit d’obtenir des actions au prix offert. Ils pouvaient alors les vendre aussitôt avec bénéfice. (…)
Le crépuscule des illusions
Il n’y eut pas d’accalmie estivale à Wall Street cette année-là. Parallèlement aux grands lancements des sociétés d’investissement, se développait le plus grand marché jamais connu. Tous les jours, les prix montaient, ils ne retombaient presque jamais. En juin, l’indice des actions industrielles du Times monta de 52 points ; en juillet, il en gagna 25 autres. (…) Puis, en août, 33 points supplémentaires. (…) C’était non seulement le prix des actions ordinaires qui montait, mais aussi, à un rythme effrayant, le volume de la spéculation. Les prêts des courtiers augmentèrent durant l’été à un taux de près de 40.000.000 dollars par mois. (…) En fait, les ruptures temporaires du marché qui précédèrent la catastrophe constituaient une épreuve sérieuse pour ceux qui en avaient écarté les caprices. Au début de 1928, en juin et en décembre 1928, en février et mars 1929, il semblait que la fin fut arrivée. A ces différentes occasions, le Times annonça avec joie le retour à la réalité. Puis le marché reprit son essor. (…) Durant cet été 1929, la bourse constituait dans la vie américaine un pôle indubitable. Et beaucoup de gens de niveau et de condition différents se retrouvaient sur le marché financier. (…) Cependant, comme aujourd’hui, pour la grande majorité des travailleurs, des cultivateurs, des employés de bureau et, en vérité, pour la majorité des Américains, la bourse était une chose lointaine et vaguement inquiétante. (…) Jamais la conviction ne fut plus solide que le marché était devenu l’instrument personnel d’hommes mystérieux mais tout puissants. Ce fut vraiment la période où les opérations de regroupement et d’union – bref les tripotages – furent extrêmement actives. Au cours de 1929, plus de cent émissions à la Bourse de New York étaient l’objet de tripotages auxquels participaient les membres de la Bourse ou leurs associés. La nature de ces opérations variait quelque peu mais, dans une opération typique, un groupe d’affairistes rassemblaient leurs ressources pour faire monter une action particulière. (…) Tant que cela durait, il n’y avait pas de façon plus agréable de faire de l’argent. (…) Tandis que le marché était de moins en moins considéré comme le registre à long terme des perspectives des sociétés et de plus en plus comme un produit de combinaisons manœuvrières, la spéculation était obligée de lui accorder une attention plus grande et de préférence totale. Les signes d’activité de groupements naissants devaient être détectés au tout premier moment, ce qui signifiait qu’il fallait avoir les yeux sur le télétype. (…)
Le 3 septembre, les ventes à la Bourse de New York s’élevaient à 4.438.910 parts ; l’argent à court terme fut à 9% toute la journée ; le taux des banques sur des effets négociables fut de 6,5% ; le taux de réescompte à la banque de la Réserve Fédérale de New York fut de 6%. Le marché était solide, avec ce que les journalistes financiers appellent une tendance favorable. (…) Le 3 septembre, le grand marché haussier des années Vingt se termina. L’économie, comme toujours, nous octroie peu de virages dramatiques. Ses événements sont invariablement flous ou même imprécis. Certaines des journées suivantes – quelques unes seulement – quelques moyennes furent effectivement plus élevées. Cependant, jamais plus le marché ne manifesta sa vieille confiance. Les pics ultérieurs n’en étaient pas, sinon comme de brèves interruption d’une tendance descendante. Le 4 septembre, le ton du marché était encore favorable, puis, le 5 septembre une rupture se produisit. L’indice des actions industrielles du Times perdit dix points et beaucoup de valeurs particulières beaucoup plus. (…) Parlant le 5 septembre devant l’Annual National Business Conference, Robert Babson remarqua : « Tôt ou tard une catastrophe viendra et elle peut être terrible. » Il suggéra que ce qui était arrivé en Floride arriverait alors à Wall Street et avec sa précision coutumière il déclara que les moyennes du marché Dow-Jones tomberaient probablement de 60 à 80 points. Dans un élan d’optimisme, il conclut : « Les usines fermeront… les hommes seront mis à la porte … le cercle vicieux se mettra à tourner et le résultat sera une sérieuse crise financière. » (cité du Commercial and financial Chronicle du 7 septembre 1929) (…)
La catastrophe
Selon la façon admise de voir les événements, vers l’automne 1929, l’économie était bien entrée en crise. En juin, l’indice de la production industrielle et celui des usines atteignirent tous deux un sommet et redescendirent. Vers octobre, l’indice de la production industrielle donné par la Réserve Fédérale se situait à 117 contre 126 quatre mois plus tôt. La production de l’acier déclina à partir de juin ; en octobre, le volume des marchandises transportées par chemin de fer baissa. La construction de logements, une industrie des plus inconstantes, baissait depuis plusieurs années, et elle s’affaissa encore davantage en 1929. Finalement ce fut au marché financier de s’écrouler. Un observateur pénétrant du comportement économique de cette période, Thomas Wilson dans « Fluctuations in income and employment », a déclaré que l’écroulement du marché « refléta, pour l’essentiel, le changement qui était déjà apparent dans la situation industrielle. » (…) En fait, toute explication satisfaisante des événements de l’automne 1929 et d’après doit reconnaître le rôle capital de la hausse spéculative et de l’effondrement qui en résulta. Jusqu’en septembre ou octobre 1929, le déclin de l’activité économique était très léger. (…) Personne ne pouvait prévoir que la production, les prix, les revenus et tous les autres indicateurs continueraient de se contracter durant trois longues et sombres années. Ce n’est qu’après la catastrophe que l’on vit des raisons plausibles pour supposer que les choses pourraient bien s’aggraver pendant longtemps encore. (…) Certains, qui observaient les indices, ont pu être persuadés par ces renseignements, de vendre, encourageant ainsi d’autres à les suivre. Cela n’est pas très important, car il est dans la nature de la hausse spéculative que presque n’importe quoi puisse la faire retomber. Tout choc sérieux contre la confiance peut provoquer la vente chez les spéculateurs qui ont toujours espéré se retirer avant l’effondrement final mais après avoir recueilli tous les gains possibles procurés par la montée des prix. (…) En Angleterre, le 20 septembre 1929, les entreprises Clarence Hatry s’effondrèrent brutalement. (…) Il devait beaucoup de son expansion à l’émission d’actions non autorisées, à l’accroissement de ses avoirs par la contrefaçon d’actions et autres formes de financement également peu orthodoxes. Dans l’histoire de 1929, on suppose que le fait d’avoir démasqué Hatry à Londres a dû porter un sérieux coup à la confiance de New York. (…)
Le jeudi 24 octobre est la première des journées que l’histoire – telle qu’on l’a écrite – identifie avec la panique de 1929. (…) Ce jour-là, 12.894.650 parts changèrent de main, beaucoup d’entre elles à des prix qui brisèrent les rêves et les espoirs de ceux qui les possédaient. (…) Souvent, il n’y eut pas d’acheteur, et c’est seulement après de nombreuses chutes verticales, qu’il se trouva des gens pour faire une offre d’achat. (…) Vers onze heures trente, le marché s’était abandonné à une frayeur aveugle et sans merci. C’était vraiment la panique. A l’extérieur de la Bourse, dans Broad Street, un rugissement mystérieux se fit entendre. Une foule s’attroupa. (…) Les actions se vendaient maintenant pour presque rien. Les Bourses de Chicago et Buffalo avaient fermé. Une vague de suicides se développa et onze spéculateurs bien connus s’étaient déjà tués. (….) A midi trente, les autorités de la Bourse de New York fermèrent la galerie des visiteurs donnant sur les scènes effrénées qui se déroulaient en dessous. (…) On parvint rapidement à la décision de grouper les ressources disponibles pour soutenir le marché. (…) La nouvelle était déjà parvenue à la Bourse que les banquiers étaient réunis et le télétype avait répandu le mot magique partout. Les prix s’affermirent aussitôt et commencèrent à remonter. (…) La peur disparut et céda la place au souci de ne pas manquer la nouvelle avance. (…) La reprise du Jeudi noir fut tout aussi remarquable que les ventes qui le rendirent si noir. (…) Les banquiers avaient montré à la fois leur courage et leur puissance et les gens applaudirent chaleureusement et généreusement. La communauté financière, déclara le Times, se sentait « maintenant en sécurité, sachant que les banques les plus puissantes du pays se tenaient prêtes à empêcher un retour de la panique ». (…)
Les choses deviennent plus sérieuses
Le trait singulier de la catastrophe de 1929, c’est que le pire continua sans cesse de s’aggraver. Ce qui paraissait un jour être la fin s’avérait le lendemain n’être que le commencement. (…) Le lundi 28 octobre fut le premier jour où le processus de climax et d’anticlimax sans arrêt commença à se révéler. Ce fut encore une journée terrible. Le volume des échanges fut énorme, bien qu’inférieur au jeudi précédent – 9,25 millions d’actions contre presque 13 millions. Mais les pertes furent bien plus sévères. L’indice des actions industrielles du Times baissa de 49 points durant toute la journée. (….) Le mardi 28 octobre fut le jour le plus dévastateur dans l’histoire de la Bourse de New York – et peut-être dans toute l’histoire des bourses. Il fut la combinaison de tous les mauvais aspects de toutes les mauvaises journées précédentes. Le volume des échanges fut immense, plus que celui du Jeudi Noir ; la chute des prix fut presque aussi grande que lundi. (….) Durant la première semaine, le massacre avait été celui des innocents. Durant la seconde, il semble que ce furent les gens aisés et les riches qui furent soumis à un processus de nivellement comparable en grandeur et en soudaineté à celui auquel Lénine avait présidé une décennie auparavant. (…)
Une rumeur épouvantable avait submergé la Bourse : le groupement des banquiers, loin de stabiliser le marché, vendait en fait des actions. Le prestige des banquiers baissait donc encore plus vite que le marché. (…) Les banques de New York affrontèrent un trou béant créé par les financiers des beaux jours et, durant la première semaine de la crise, elles augmentèrent leurs prêts d’environ un milliard. (…) Il était alors également évident que les sociétés d’investissement, autrefois considérées comme une défense solide contre l’effondrement, étaient en réalité une source de faiblesse profonde. Le levier, dont les gens, une quinzaine de jours auparavant, parlaient encore en connaisseurs et même avec affection, fonctionnait maintenant en sens inverse. Avec une célérité remarquable, il enleva toute valeur aux actions ordinaires des sociétés. (…) A la mi-novembre 1929, enfin le marché s’arrêta de baisser – tout au moins pour un temps. Le creux eut lieu le mercredi 13 novembre. Ce jour-là, l’indice des actions industrielles du Times ferma à 224, contre 452 (soit presque la moitié) le 3 septembre. (…) La chute était à bout de souffle. (…) En janvier, février et mars 1930, la Bourse marqua une reprise substantielle. Puis, en avril, la reprise perdit de son élan et, en juin, il y eut une nouvelle forte chute. Ensuite, avec de rares exceptions, le marché baissa toutes les semaines, tous les mois et tous les ans jusqu’en 1932. Le point où il s’arrêta fit paraître comme un sommet, par contraste, le niveau le plus bas atteint durant la catastrophe. Le 13 novembre 1929, on s’en souvient, l’indice des actions industrielles du Times ferma à 224 ; le 6 juillet 1932, il était à 58. Cette valeur n’était guère plus que le montant de la baisse dans la seule journée du 28 octobre 1929. (…) Cependant, comparativement, les valeurs de ces actions principales se maintenaient encore bien : les choses étaient pires pour les sociétés d’investissement.
Causes et conséquences
Après la grande catastrophe, vint la grande crise qui dura, avec une gravité variable, pendant dix ans. En 1938, le produit national brut (la production totale de l’économie) était presque d’un tiers inférieur à celui de 1929. Ce ne fut pas avant 1937 que le volume de la production retrouva les niveaux de 1929 et pour baisser de nouveau rapidement. Jusqu’en 1941, la valeur en dollars de la production demeura inférieure à celle de 1929. Entre 1930 et 1940, une seule fois, en 1937, le nombre moyen des chômeurs pour l’année tomba au dessous de huit millions. En 1933, il y avait presque treize millions de sans-travail, soit un quart de la main d’œuvre disponible. En 1938, une personne sur cinq était sans travail. (…) Dans l’ensemble, la grande catastrophe de la Bourse peut être beaucoup plus facilement expliquée que la crise qui a suivi. (…) Comme on l’a souligné bien souvent, l’effondrement de la Bourse à l’automne 1929 était implicite dans la spéculation qui l’a précédé. La seule question concernant la spéculation était de savoir combien de temps elle durerait. (…) Les causes de la Grande Crise sont encore loin d’être certaines. (…) Aucun rythme inévitable n’appelait l’effondrement et la stagnation de 1939-40. (…) En fait, la production élevée des années Vingt n’a pas, comme certains l’ont suggéré, dépassé les besoins des gens. (…) Pendant les années Vingt, la production et la productivité par travailleur ont progressé régulièrement : entre 1919 et 1929, le rendement par travailleur dans les industries de fabrication s’était accru d’environ 43%. Les salaires, les traitements et les prix (…) ne subirent aucune augmentation sensible. Par conséquent, les coûts baissèrent et, les prix restant les mêmes, les bénéfices augmentèrent. Ces bénéfices soutinrent les dépenses des classes aisées et ils alimentèrent également certaines des espérances apparues dans le boom de la bourse. Mais surtout, ils encouragèrent un niveau élevé d’investissement des capitaux. (…) L’effet d’investissements insuffisants – investissements qui ne pouvaient suivre le rythme régulier de l’accroissement des bénéfices – pouvait se traduire par une demande totale en baisse, se reflétant à son tour dans une baisse des commandes et de la production. (…) »

Sur la crise de 1929
Extraits de « Histoire économique et sociale du monde » de P. Léon :
« La grande crise du monde capitaliste
« La crise débuta en octobre 1929 aux Etats-Unis par une crise boursière ; elle prit rapidement un caractère mondial, elle fut longue et atteignit son paroxysme lorsque la production tomba au plus bas : 1931 en Grande-Bretagne, 1933 aux Etats-Unis et 1935 en France. Les différents rouages de la vie économique furent successivement touchés. Ainsi, le krach de Wall Street engendra une nouvelle chute des prix de 1929 à 1932, dans laquelle vinrent d’inscrire en mai 1931 une crise française et, à partir de septembre de la même année, une crise monétaire. Malgré la diversité de ses manifestations, loin de constituer une série de crises qui venaient s’ajouter accidentellement les uns aux autres, le cataclysme était dû à un enchaînement de causes.(…) Une nouvelle chute des prix, dont le centre fut encore une fois les Etats-Unis, eut lieu dans le second semestre de l’année 1937 et la production mondiale ne se releva vraiment que grâce à la course aux armements pendant l’année 1938 (…) La crise du capitalisme eut de multiples aspects qui sont indissociables. Par commodité, les répercussions sociales et les luttes qu’elle provoqua sont traitées à part : le danger d’un tel parti pris assimilable à l’économisme est de faire tout dépendre de la politique économique (…)
La flambée sur le cours des actions à la Bourse de New York avait commencé en 1927-1928 : l’indice des valeurs industrielles indique un doublement des cours en moins de deux ans (début 1928 : 191 ; décembre 1928 : 300 ; septembre 1929 : 381). Bien que cette poussée n’eût rien d’exceptionnel dans l’histoire de la Bourse, elle expliquait assez bien la fièvre du public. Les transactions en 1929 portaient en moyenne sur 42 millions de titres par jour, avec parfois des montées en flèche à 82 millions comme en mars 1929. La hausse du nombre de transactions ne présentait aucun danger en soi. Le fait que certaines actions passaient entre plusieurs mains en peu de temps dénotait pourtant le caractère spéculatif de ces mouvements. Le nombre des Américains qui jouaient à la Bourse était autour de 1,5 millions sur 122 millions d’habitants, mais en réalité le marché se cristallisait autour de quelques milliers de spéculateurs parmi lesquels Samuel Insull, Charles Mitchell de la National City Bank et Albert Wiggins de la Chase Bank. Comment expliquer tout d’abord l’abondance des titres mis sur le marché ? Principalement par la transformation rapide des structures sociales de l’entreprise – de la firme familiale à la société anonyme - et par l’habitude prise par les grandes affaires de prévoir à l’avance, au moyen d’augmentations anticipées du capital, leurs projets d’investissements à long terme. A quoi il faut ajouter la multiplication caractéristique de l’époque des sociétés d’investissement qui n’étaient que des pyramides financières fondées sur l’achat, en principe, de bons portefeuilles afin d’offrir à l’épargnant la possibilité de jouer sans risques. D’où provenait en second lieu la flambée des cours ? (…) Dans l’atmosphère de prospérité générale qui régnait et surtout par suite du manque d’informations des épargnants, un mouvement excessif d’anticipation à la hausse avait eu lieu, surtout dans les secteurs à la traîne et dans les affaires risquées. La spéculation n’avait plus aucun lien avec le montant des dividendes distribués, elle se fondait sur la hausse des cours des actions et prenait manifestement un caractère de plus en plus psychologique. (…) L’un des phénomènes les plus caractéristiques de cet emballement de Wall Street fut la forte croissance des prêts aux courtiers. Ils doublèrent de fin août 1926 à fin novembre 1928 et augmentèrent encore d’un tiers à partir de cette date jusqu’à fin septembre 1929. (…) L’édifice du crédit boursier était donc tout aussi fragile que celui du crédit international ; de plus, il pompait les liquidités du monde. Le gouvernement fédéral était d’ailleurs convaincu du danger de la situation ; cependant il hésita longtemps avant d’intervenir, le seul moyen qu’il eût à sa disposition pour réduire la masse monétaire en circulation étant de relever le taux d’escompte. Or, une telle manipulation ne pouvait qu’accentuer la récession économique qui était apparue fortement dans le bâtiment, voire l’automobile. Le 6 août, ce taux fut finalement porté à 6%. (…) Il n’y eut pour le moment point de résultat sur la Bourse. La crise débuta le 23 octobre et le jeudi 24, le fameux jeudi noir, ce fut la panique : 13 millions de titres furent cédés, 16,5 millions d’actions furent encore liquidées le 29. Malgré l’intervention d’un syndicat de banquiers (Morgan, Mitchell, Wiggin, …) qui avança un milliard de dollars pour couvrir des prêts à vue, malgré celle du Système Fédéral qui fournit également des fonds – ce qui était contraire à la loi – et qui abaissa le taux d’escompte à 5 puis 4,5%, le krach dura 22 jours. Ce fut le plus long de l’histoire. (…)
Comment expliquer le retournement du cycle boursier ? Il faut noter d’abord que les difficultés des affaires et de l’emploi avaient commencé bien avant, de part et d’autre de l’Atlantique. Le resserrement de la production, des prix et de l’emploi en Europe – sauf la France – datait du premier trimestre de 1929 (déjà 1,9 millions de chômeurs en Allemagne). Aux Etats-Unis, la construction des villas de luxe s’était fortement ralentie dès le printemps, la production des automobiles avait atteint le chiffre record de 622.000 en mars, avant de retomber à 416.000 dès septembre. Dans le cas américain, les trois indicateurs précités qui cernent l’activité économique changèrent de direction à partir de juin. (…) La crise boursière ne fut qu’un « maillon de la chaîne » qui désagrégea les économies occidentales. Certes, à la fin de l’année 1929 et au début de 1930, des liquidités réapparurent à la suite du renversement des politiques d’escompte des banques centrales. Il était trop tard. En raison de la contraction du crédit au moment du krach, le phénomène de déflation des prix avait atteint un nouveau palier qui fut longtemps irréversible. A son tour, la déflation, cette fois générale, provoqua un réflexe de retrait des fonds et de thésaurisation d’une tout autre ampleur qui fit éclater au grand jour la crise économique. La spéculation boursière avait donc masqué pendant un temps la contradiction entre l’existence d’une suraccumulation mondiale de capitaux et une économie qui végétait faute de débouchés. Le krach fut moins dû à la prise de conscience de l’inanité d’une telle spéculation qu’aux déséquilibres supplémentaires que la Bourse créait. »

La crise des années 70 comparée à celle de 1929
« La crise actuelle est-elle la répétition de celle de 1929 ? » de Robert Boyer
article pour le n°8206 de la revue du Cepremap (centre d’études prospectives d’économie) :
« Lors des années vingt, la forte croissance de l’économie repose sur un boom de l’accumulation portant de façon privilégiée sur la section des moyens de production. Quant à la croissance de l’emploi, elle est dans sa quasi-totalité dépendante du succès de l’accumulation puisqu’elle est uniquement le fait de la section 1. La crise de 1929 apparaît donc comme une crise de suraccumulation dans la section 1, ce qui explique que, de 1929 à 1938, la chute de l’accumulation, différentiellement plus marquée dans la section 1, impose le retour à une relative cohérence des deux sections mais au prix d’une contraction cumulative de la production et de l’emploi. A l’opposé, à partir de la fin des années cinquante, l’accumulation se porte simultanément sur les deux sections, signe d’une forme nouvelle d’articulation entre les conditions de production – tout particulièrement dans la section 2, initialement retardataire par rapport aux normes américaines – et les conditions de vie des salariés. (…) Dans la crise actuelle – tout comme de 1930 à 1938 – la montée du chômage ne dérive pas de désajustements conjoncturels, mais bien de l’arrivée aux limites d’un régime d’accumulation – lui-même conséquence d’un ensemble de formes structurelles ou institutionnelles originales. (…)
Le mode de croissance de l’après seconde guerre (…) a buté aux Etats-Unis depuis le milieu des années soixante (…) sur les limites de l’approfondissement de la division sociale et technique du travail, hypothéquant la poursuite des gains de productivité élevés, base sur laquelle repose la stabilité du mode de croissance due en particulier à la complémentarité salaire-profit d’une part, consommation et investissement de l’autre. (…) Aux Etats-Unis dans le milieu des années soixante se manifeste un problème majeur de productivité industrielle, que ces difficultés naissent du caractère de plus en plus coûteux du développement des forces productives ou des luttes des travailleurs (…). Si la crise de 1929 était marquée par l’incompatibilité entre un taux de profit – trop haut – et des perspectives de réalisation – insuffisantes du fait même du niveau du taux de profit -, la dynamique à l’œuvre après 1945 se manifeste au contraire par une très grande régularité de la croissance qui conserve jusqu’en 1973 un niveau élevé. (…) C’est l’ensemble des formes institutionnelles, d’un régime d’accumulation intensive centrée sur la consommation de masse et d’une régulation dite « monopoliste » qui entre en crise au début des années soixante-dix. (…) Apparemment, les années 1930-1931 d’une part, 1974-1975 de l’autre, font apparaître une étonnante similitude quant à la contraction de la production industrielle et du PIB (environ – 11% pour la première, – 4% pour la seconde). De la même façon, l’investissement se contracte massivement bien qu’à un rythme moindre en 1975 (- 7% contre – 15%). De fait, au-delà de ces similitudes, on enregistre deux différences fondamentales :
– Après la chute de la production pendant quatre trimestres, le mouvement se renverse au milieu de l’année 1975 alors que la dépression ne cesse de s’approfondir jusqu’en 1932 ;
– Au cours des deux années sous revue, une différence fondamentale tient à l’opposition entre une déflation qui va s’approfondissant (respectivement
–2,8% et -7,5% de chute des prix à la consommation en 1931 puis 1932) et la poursuite de l’inflation à un rythme élevé peu affecté par l’ampleur de la récession (10,9% et 9,6% par an en 1975 et 1976). (…)
Si la récession (des années soixante-dix) s’arrête au bout de quatre trimestres, c’est pour l’essentiel du fait de la poursuite d’une forte croissance de la consommation des ménages (+ 4,2% par an) alors qu’au contraire elle avait chuté de 1930 à 1931 (-5,1%). Ainsi s’explique qu’après une première année de réduction de l’investissement, ce dernier se remette à croître légèrement, du fait des pressions qu’exerce la demande finale sur les capacités de production d’abord dans le secteur des moyens de consommation et par extension dans celui des moyens de production. Enfin, la reprise de la croissance des exportations au milieu de l’année 1975 s’oppose à l’effondrement qui survient de 1931 à 1932, lui-même conséquence de la montée du protectionnisme et de la dislocation des relations internationales qui marquent les années trente. (…) Le contraste entre l’effondrement de la consommation dans les années trente (son taux annuel de variation passe de 2,3% à – 3,8% après 1930) et la très légère décélération après 1974 (de + 4,9% à + 3,6% par an) est frappant (…)
La crise actuelle trouve son origine dans le divorce entre un niveau de taux de profit trop bas et la poursuite d’une croissance des débouchés de moyens de consommation, impulsée par le rapport salarial, dans un premier temps tout au moins. Dans un second temps, le blocage de l’accumulation a pour conséquence de réduire le dynamisme de la consommation, crise liée à l’insuffisance de la rentabilité et récession dérivant de la contraction de la demande effective cumulant leurs effets. Tout le problème est alors celui du relèvement du taux de profit. (…)
Il est clair que la complexité de ce réseau de contradictions marque l’arrivée aux limites du mode de développement lui-même et non pas un « dérèglement passager ». (…) Quelles qu’en soient les causes (suraccumulation liée à la montée de la composition technique ou à une croissance « disproportionnée », conséquence de la spéculation financière, …), les crises trouvent leur origine dans une baisse du profit qui, contractant l’accumulation, déclenche une chute de la production, donc de l’emploi. La reprise intervient lorsque les faillites industrielles et bancaires et le chômage induisent un relèvement du profit suffisant pour enclencher une nouvelle phase d’expansion, initiée par la restauration des bases de l’accumulation (abondance des réserves de main d’œuvre, salaires bas, possibilités de crédit … donc haut niveau du taux de profit). (…)
Une crise cyclique correspond à un épisode de chute de la production, d’effondrement de l’accumulation, de faillites industrielles et bancaires selon un mouvement assurant la reconstitution quasi automatique des bases d’une reprise de la croissance à formes institutionnelles globalement inchangées. A l’opposé, une crise structurelle, ou grande crise, désigne un épisode au cours duquel la dynamique de la reproduction économique entre en contradictions avec les formes sociales et institutionnelles sur la base desquelles elle opère. »

Messages
1. Nouvelle crise mondiale et limites du capitalisme, 24 octobre 2008, 23:21
Quoi qu’il en soit de nos désaccords, merci de cet outil utile et la mise à disposition d’une telle richesse d’articles publique.
J’ai lu avec un grand intérêt et très attentivement ces thèses sur la crise systémique. Un point important me paraît franchement discutable : La mort du capitalisme.
Il est une comparaison actuelle assez superficielle de comparer la crise actuelle avec celle de 1929. Ce ne sont pas les mêmes conditions. La crise boursière est arrivée 1 an et demi après le début de la crise financière et économique, immobilière, etc. Alors qu’en 1929, c’est le krach boursier qui a amorcé la crise économique et sociale mondiale qui a mené Hitler au pouoir et à la guerre de 1939-1945.
Cependant, la référence journalistique actuelle permet, sans le dire clairement de préparer l’opinion à la suite de 1929 : fascisme, investissements guerriers (qui ont déjà commencé) et guerre mondiale.
La crise est un fonctionnement normal du capitalisme. Les crises sont cycliques. Guérin explique que le XXe siècle apporte autre chose que ces crises cycliques. Les cycles continuant de fonctionner, c’est la crise chronique qui s’installe. Ainsi crises cycliques et crise chronique se mêlent et mènent au fascisme, aux dictatures, la répression des révolutions et la guerre.
La double guerre de 1914 à 1945 a permis de relancer la machine du système. Il a fallu tout détruire pour pouvoir reconstruire ensuite. Détruire la classe ouvrière consciente et détruire le capital accumulé dans les constructions et les moyens de production.
C’est ce qui nous attend, et la seule discussion restante (fort spéculative et au fond peu utile) est de savoir à quelle rapidité le scénario de la grande destruction sera rejoué.
Cependant, si rien n’est tenté pour abattre ce système, le scénario sera rejoué : destruction pour relancer la machine productive. Les capacités productives actuelles ne permettront certainement pas de relancer la machine productive pour 63 ou 70 ans. Personne ne peut prédire pour combien de temps, mais certainement pas pour aussi longtemps.
En ce sens, annoncer la mort du capitalisme me parait prématuré : pour le moment, je continue à payer mon pain ou mon café en euros, et rien dans les rapports sociaux n’a changé, même si tout tend à ce que cette situation ne dure pas.
Le capitalisme, si nous ne l’aidons pas à mourir, renaîtra après la grande destruction. Dès lors, pourquoi annoncer dès maintenant sa mort, alors qu’il faut une classe ouvrière consciente d’elle-même pour pouvoir abattre l’État qui sert à faire perdurer un système suranné ?
1. Nouvelle crise mondiale et limites du capitalisme, 25 octobre 2008, 20:29, par Robert Paris
Merci de ta contribution.
Quelques soient nos désaccords, il va falloir nous poser les problèmes d’une situation tout à fait nouvelle, et le faire ensemble est une bonne chose. Nul ne peut donner une réponse à un problème d’une telle envergure seul, je veux dire seul dans son groupe, dans son organisation ou dans son regroupement international. Les révolutionnaires doivent discuter ensemble de leurs analyses et des réponses possibles. Même s’ils ne parviennent pas d’emblée à un point de vue commun. Ils doivent aussi discuter autour d’eux le plus largement possible. Même si les gens avec lequels ils discutent ne les croient pas. Penser à la fin du système leur semble aussi irrationnel que penser à la fin du monde...
Mais, d’abord, il faut une analyse de la situation. Le capitalisme connaît une crise, mais quelle est cette crise, quelle en est la cause et quelle en est la profondeur. Cependant, il y a d’emblée un problème. En sciences, - et nous souhaitons de la politique révolutionnaire ait l’ambition d’être une science -on ne peut se contenter de ce que l’on voit. Tu continues à payer ton pain et ton café et, sous ce prétexte, tu ne vois pas la mort du capitalisme. Bien ! Mais les plus grands capitalistes la voient depuis plus d’un an et c’est leur panique qui marque la crise. Les gens, les travailleurs, les petits et les moyens bourgeois et même les petits capitalistes veulent croire que cela va s’arranger. Les gros ne le croient pas. Ils misent leur argent sur ce qu’ils estiment probables. Et, ainsi, tous estiment probable sa chute. Ils misent sur l’effondrement. Et ce n’est là qu’un simple problème de confiance. Ils ont de solides raisons pour cela. La crise systémique est un problème objectif. La raison de fond, je l’ai exposée brièvement : il y a suraccumulation. Le problème ne se pose pas de la même manière à un capitaliste et aux autres hommes. Nous avons besoin de moyens pour vivre. Les riches souhaitent avoir beaucoup d’argent. les capitalistes ne sont pas seulement des riches. ce sont des investisseurs. S’il n’y a plus moyen de trouver où investir ils sont affolés.
Tu affirmes que le capitalisme ne s’écroulera pas sans intervention consciente du prolétariat. Il ne s’agit pas là de la même question. La classe dirigeante ne va pas quitter d’elle-même le pouvoir même si elle estime elle-même que le système ne fonctionne plus. Les Etats bourgeois ne vont pas céder la place. L’exploitation ne va pas disparaitre. Elle va seulement être bien plus barbare. Tous vont être plus violents que jamais.
Quel avenir ? En disant que le système capitaliste ne fonctionne plus, nous ne sommes pas en train de dire qu’une autre société va naître spontanément. Nous ne disons même pas que la société va changer et abandonner la loi du profit et l’exploitation. Nous ne pouvons pas dire quelle va être la suite. Et nous ne pouvons même pas dire que si nous laissons les capitalistes diriger, le capitalisme retrouvera une nouvelle prospérité... un jour. Car il va devoir d’abord détruire l’essentiel des richesses et une bonne partie des êtres humains ! Dire que le système en tant que fonctionnement a rendu l’âme ne signifie pas qu’il ait un automatisme qui permette de passer à une société nouvelle. L’histoire des grands empires le prouve. Un système peut même s’écrouler sans qu’il donne naissance à une société supérieure. Rien ne prouve, par exemple, que l’humanité survivrait à une nouvelle guerre mondiale. Alors quel est l’intérêt de dire que le capitalisme, dans son principe, est déjà mort ? Cela change la manière de discuter des perspectives. S’il y a une crise conjoncturelle, les travailleurs doivent éviter d’en payer le prix. Si la maison va s’effondrer, il faut en sortir avant ! Parler de fin du système n’est pas une manière de tromper les gens sur la situation mais au contraire une manière de les amener à se poser le principal problème : dans quel société voulons nous vivre ?
Car il ne suffit pas d’avancer des "revendications". Il faut qu’elles mènent en dehors du système actuel. C’est d’une perspective que les travailleurs et les peuples vont avoir besoin de manière urgente. C’est en l’absence d’une telle perspective que les peuples sont tombés dans le piège des fronts populaires puis des fascismes.
Notre responsabilité est grande. Elle nécessite d’avoir une boussole politique...
Robert Paris
2. Nouvelle crise mondiale et limites du capitalisme, 25 octobre 2008, 21:25, par marcus
salutations
De ce que l’auteur de ces lignes a compris, la "mort du capitalisme" dans les thèses signifie que dans la période qui vient il ne se relèvra pas que si d’mmenses destructions de richesses et de forces productives comme celles de la première ou de la deuxième guerre mondiale suivent la crise en cours. En effet le mécanisme de l’accumulation a atteint ses limites.
Cela ne veut pas dire que l’effondrement du capitalisme sera suivi de la mise en place d’un autre système économique et social comme le communisme. Une telle perspective doit être consciemment défendue comme il est d’ailleurs rappelé dans les thèses.
Il ne faut pas oublier que Marx parlait de socialisme...et de barbarie. Dans la période qui vient les deux possibilités vont coexister et il dépendtra de la classe ouvrière et de ses organisations révolutionnaires de faire triompher la première alternative.
Marcus
3. Nouvelle crise mondiale et limites du capitalisme, 26 octobre 2008, 14:33, par Robert Paris
La crise : ordre ou désordre ?
C’est la crise.
Tout le monde le sait. Tout le monde le voit. Mais on a du mal à la comprendre.
Des crises, il y en a eu de nombreuses. Il y a presque toujours une crise, à un niveau ou à un autre dans cette société. De quel type de crise s’agit-il ?
Mais qu’est-ce que la crise ?
Pour tout le monde, la crise, c’est le désordre.
En fait, la crise, c’est un trop grand ordre !
Quand le système fonctionne, c’est le désordre des marchés qui changent sans cesse, dans un sens puis dans l’autre, sans être prévisibles à long terme, qui donne sa structure au système. En période de crise, tous les capitalistes jouent à la baisse en même temps sur tous les marchés. Il y a des petites phases de hausse où tout monte, puis tout redescend encore plus bas. Les rythmes qui continuent à exister ne sont plus du même type. Ce sont des rythmes trop ordonnés. Ce type de rythmes montre que le système est atteint.
De telles crises systémiques peuvent avoir lieu dans un système social aussi bien que dans un système biologique. Quand les rythmes du cœur sont trop réguliers, quand le message du cerveau est trop ordonné, c’est la maladie grave.
Que veulent les capitalistes ?
Le système est menacé. On le sait puisqu’on n’arrête pas de nous dire qu’il faut toujours prendre des mesures plus radicales et des mesures impressionnantes pour sauver le système. Mais par qui le système est-il menacé ? Par les marchés, nous dit-on. C’est-à-dire par les possesseurs de capitaux !
Qu’est-ce qui leur prend, à ces capitalistes, d’agir de façon à détruire le système qui était le leur ?
Ils ne font rien de spécial. Ils ne font que fonctionner comme d’habitude. Investir et retirer leurs capitaux en fonction d’anticipations des résultats à venir. Mais toutes leurs anticipations leur disent que cela va s’effondrer. Et ils ne peuvent qu’y répondre en vendant, en accroissant la chute …
Ils sont en train de détruire le système en fonctionnant comme ils le faisaient avant et pourtant, maintenant, cela a comme résultat de démolir tout l’édifice.
Chaque jour, leurs désinvestissements signifient : cette société va s’effondrer.
D’où leur vient cet affolement ? Il vient du fait que les investissements rentables ont tous été épuisés et qu’ils ne peuvent plus trouver des achats dont ils estiment qu’ils vont rapporter du profit. Ce ne sont pas seulement les financiers, ce sont tous les grands capitalistes qui sont les artisans de la crise de leur propre système.
Est-ce quelque chose de si étonnant ? Pas du tout. Dans les crises systémiques, c’est toujours le cas. C’est la classe dirigeante qui ne peut plus fonctionner.
Quand un système atteint ses limites ?
La société féodale s’est écroulée à partir de 1789 du fait d’une crise provoquée en 1788 par la noblesse. La société pharaonique égyptienne s’est écroulée en 2350 avant J.-C du fait d’une crise au sein de la classe dirigeante qui a relancé le féodalisme au détriment du pouvoir central. Les révolutions qui ont suivi ces crises au sein de la classe dirigeante n’effacent pas le fait qu’il a fallu les conditions objective (les classes dirigeantes ne peuvent plus gouverner comme avant) pour que les classes opprimées se posent le problème d’intervenir et fassent la révolution (ou, parfois, que la classe dirigeante fasse une contre-révolution ou une guerre préventive). Les guerres mondiales, les crises mondiales n’ont pas été provoquées par les opprimées. Les révolutions sociales n’ont été que le produit des crises de la domination de classe, et non le contraire.
C’est le capitalisme qui sonne la fin de son système. Bien entendu, cela n’enlève nullement aux opprimés, aux travailleurs, leur propre rôle pour bâtir une autre société.
La fin d’un système, qu’est-ce que cela signifie ?
Ce terme, qui est utilisé dans nos thèses, a fait réagir de nombreux lecteurs.
Pourquoi parler de mort du système alors que ce sont les travailleurs qui peuvent, et eux seuls, en finir définitivement avec la société de classe, son exploitation et son oppression ?
Il y a une différence entre une crise conjoncturelle, espèce de respiration un peu violente du système à de multiples échelles (crise d’une entreprise, d’un secteur, d’un pays, d’une région) et une crise systémique.
Quand le fonctionnement n’est maintenu que par des intubations artificielles (à coups de centaines de milliards de dollars ou d’euros) qui permettent tout juste d’éviter la mort immédiate, c’est que le patient (Sharon par exemple) est très gravement malade. S’il s’agit de lui envoyer des doses phénoménales de sérum, de le nourrir et de le faire respirer artificiellement, on peut imaginer qu’il sortira à un moment du coma. Mais à condition que tous les hommes autour de lui ne soient pas dans le même cas. L’économie du Japon peut passer par un trou. Ou celle de l’Asie. Quand c’est l’économie mondiale c’est comme si tous les médecins autour de Sharon étaient eux aussi dans le coma ! Là, c’est fini.
Cela change considérablement la perspective. La nécessité de la révolution sociale ne provient plus seulement de la révolte contre le système mais du fait que le bateau coule. Qu’on le veuille ou pas, il va falloir construire autre chose.
Il ne va pas s’enfoncer en une fois. Par contre, quand il commencera à sombrer, cela ira vite. Il faut s’y préparer.
Et ceux qui défendront qu’on peut encore prendre des mesures pour vivre sous son égide seront des gens dangereux.
Robert Paris
4. Nouvelle crise mondiale et limites du capitalisme, 26 octobre 2008, 15:07, par Robert Paris
Comparer la crise actuelle et la crise de 1929 ?
Un lecteur nous dit que c’est une comparaison superficielle.
Dans toute comparaison, il est bien évident qu’il n’y pas identité. Le monde capitaliste de 1929 n’est pas identique à celui de 2008.
Le problème est de savoir si la comparaison éclaire la compréhension du phénomène ou si, au contraire, elle en cache les bases fondamentales.
Dans la forme, en 1928 éclate la crise immobilière de la Floride. Des quantités d’investissements se sont vendus de manière incroyables, fondés non sur de vraies maisons mais sur le fait que les titres (donnant droit à une maison) s’achetaient parce qu’ils allaient se revendre encore plus cher. Sur le fond, le problème était que les circuits d’investissements étaient englués alors que des capitaux existaient à foison, bien au-delà des possibilités d’investissements. C’était une crise de suraccumulation qui s’est transformée en crise boursière, financière, bancaire, suivie d’une grave récession, le tout parti des USA et gagnant l’Europe et le monde…
Apparemment, la comparaison n’est pas absurde.
Bien sûr, la comparaison n’est pas innocente t notre lecteur a raison de dire que cela fait penser au lecteur qu’il peut y avoir les mêmes conséquences : le fascisme, la guerre mondiale.
Il y a une alternative : la révolution sociale.
Pourquoi cette comparaison a son importance : parce que les travailleurs des années 30 ont mené de grands combats, en Espagne, en France, aux USA, au Vietnam et ailleurs, mais souvent sans avoir conscience des enjeux : socialisme ou barbarie !
Robert Paris
5. Nouvelle crise mondiale et limites du capitalisme, 26 octobre 2008, 21:29, par Robert Paris
Mes amis de « Matière et révolution », je vous rapporte notre discussion :
BONJOUR L’AMI,
BONJOUR L’AMIE
1...l’ami, dit-moi ça fait plusieurs semaines que tous les médias et tous les gens parlent de crise financière, mais c’est quoi une crise ?
R...une crise c’est le produit d’une contradiction entre deux ou plusieurs choses qui ne se supportent pas, se repoussent, mais et pourtant sont condamnés à rester ensemble, imbriquées l’une dans l’autre, qui forment un système jusqu’à une certaine limite et pendant un certain temps, jusqu’à ce que cette contradiction prenne un tour violent. Par exemple, l’organisation du monde aujourd’hui est le système capitaliste : un ouvrier comme toi ou une ouvrière comme moi travaillant dans sa boite peut être licenciée et se retrouver à la rue, sans rien, que ce dernier aime ou n’aime pas son travail. Ton emploi n’était pas à toi. La crise montre que même ton compte en banque n’était pas vraiment à toi puisque, si la banque fait faillite, l’Etat aide les financiers, mais, si banque est fermée, c’est avec tout ce que tu as pu épargner qui est disparu pour toi ; si tu perd ton emploi, il n’y a plus d’embauche possible, et tout ce cauchemar impensable et contradictoire fonctionne dans ce même système organisé par les hommes à un moment donné de leur histoire. Un autre exemple, c’est toi, c’est moi, un système formidable, une structure biologique organisée, mais dont la mort est complètement imbriquée dans la vie. Aucun système n’est éternel et aucune structure ne peut s’étendre à l’infini. Si le système a atteint ses limites, il est comme un être vivant : tout va s’effondrer assez vite. C’est une crise de tout le système en réalité. C’est mensonger de dire que la crise est seulement financière, donc cette prétendue crise financière est une crise systémique tout court.
2....mais l’amie ce que tu dis est grave, et même il faut absolument que tous les organisateurs du monde politique, économique et social voire culturelle, etc, se réunissent dans les grandes capitales du monde pour trouver des solutions, pour le moraliser, pour aider les banques, les grandes entreprises, à ne pas disparaître, bref pour que le système fonctionne car, si la situation est grave, les conséquences sur ma gueule et ta gueule peuvent être catastrophiques du jour au lendemain ?
R....OUI l’ami c’est peut être grave mais, pour savoir pour qui, il faut partir de quelques réalités qui sont :
1 tu penses que les Etats actuels sont là pour ta gueule ? Eh bien tu rêves.
Non ! Ces Etats-là sont, de bout en bout, au service de la classe dirigeante. Ils peuvent faire semblant et même dire que c’est pour toi qu’ils agissent aussi, qu’il servent tes intérêts, qu’un Etats et ses chefs c’est pour tout le monde. Cela trompe qui le veux, mais tu peux constater que, si un chef d’Etat de n’importe quel pays au monde se déplace d’un bout du monde à l’autre, c’est pour 3 raisons : vendre des biens des riches, acheter des bien des riches ou s’attaquer à un problème en rapport avec la lutte contre la classe ouvrière.
2 Tu penses que les entreprises sont a toi ou, au moins, sont là pour toi : pour que tu travailles, pour que tu consommes ? Tu rêves :
Non, ces entreprises ne sont pas là pour toi. Elles ne peuvent qu’à condition de mettre en cause l’appartenance de ses propriétaires actuels. En termes clairs, une terre, une usine, etc, etc… est à celui qui la travaille et non à celui qui profite de ces richesses sur le dos des travailleurs ? Oui, sur ce plan ton rêve peut devenir réalité, si tu te donnes les moyens de comprendre le fonctionnement du système
3 Tu penses que les chefs d’Etat travaillent pour toi en se réunissant tous les jours, par ci et par là ? Tu rêves.
Non, mon cher ami, il travaille pour les riches, pour sauver le grand capital qui est dans un état comateux, parce que il est arrivé au sommet de ses possibilités d’agrandissement par accumulation et il s’effondre tout seul. Non, mille fois non, il ne travaille pas pour toi. Pour t’en assurer, c’est facile : déclenche une bonne grève dans ta boite et tu verras si ces Etats et leurs corps d’armée sont là pour toi ou pas.
4 Tu penses que leurs banques sont la tienne ? Tu rêves.
Non, mon cher ami, pour toi, dans ta tête, parce que c’est courant de dire « ma banque » autour de nous, il est fréquent de ne pas comprendre à qui appartient le monde. On pleure, comme beaucoup d’entre nous en ce moment : « ho la la, comment ça se fait que rien n’est fait pour nous, les ouvriers et les travailleurs en général, que l’Etat voit la paupérisation partout mais ne fait rien, alors qu’il débloque des sommes inimaginables par centaines de milliards d’euros pour sauver des banques et d’autres grandes entreprises ? Parce que tous les Etats du monde sont pour les riches. Toi qui travaille pour ton patron, regardes autour de toi et dit moi, depuis la naissance du capitalisme, quelles usines, quelles banques, quelles grandes propriétés ne sont pas aux capitalistes et ne sont pas défendues par des Etats qui se disent pourtant démocratiques ?
5 Tu penses que les organisations politiques, économiques, associatives, syndicales, que sais-je, actuelles sont là pour nous défendre, nous les travailleurs et les sans rien ?
Tu rêves.
Non, là aussi tu te plantes : nous, les ouvriers, on se réclame de toutes ces organisations pour un milliard de raisons. Nous disons et pensons que ces organisations nous défendent et qu’elles sont là pour nous, etc, etc… C’est quelque chose qui existe dans nos têtes mais n’a rien à voir avec la réalité. La réalité est qu’il nous haïssent en tant classe et nous mentent pour qu’on mange bien la soupe empoisonnée du réformisme ; par exemple, ces quelques mensonges à la mode en ce moment mis en avant par tous les chefs d’états, les chefs syndicaux, les chefs de l’économie, les chefs associatifs : c’est qu’il faudrait moraliser le système capitaliste, plus jamais de magot pour les chefs d’entreprises qui s’en vont, plus jamais de corruption, bref plus de contrôle, etc, etc… Mais, mon cher ami, tant qu’il y a de l’argent il y aura toujours de la corruption, tant qu’il existera d’achat et de vente ; il y aura des magots emportés tant qu’il y aura des sans rien qui n’ont que leur force de travail et ceux qui ne travaillent absolument pas et qui ont toutes les richesses du monde ; c’est mensonger de dire qu’il peut y avoir quelque chose de moral dans ce système et figures-toi que toutes ces idées sont mises en avant pour qu’on les accepte et pour ne jamais se battre contre leur ordre mondial.
3....oui, mais l’amie, je suis tout seul, dans mon coin de travail chez moi, etc, etc… et tu me poses tous ces problèmes comme si j’étais coupable, de près ou de loin, responsable de tout ça, même si moi je reste persuader que non je ne suis pour rien mais admettons que oui, tu propose quoi concrètement sachant que tu détestes ce mots concret et moi j’aime ce mot par ce que je vois mal ce que je peux faire, ou dire, lire, ou discuter ?
R....distribuer, et défendre les idées de ce papier à des amis. Tu m’as toujours dit que je te gavais avec ce site qui s’appelle matière et révolution parce que toutes mes idées tirent leur source de ce site, et vu que tu aimes bien l’informatique tu pourras directement écrire en répondant sur tous tes désaccords ; mais je sais que tu as tellement peur de savoir que ça ne m’étonnerai pas que tu n’y aille pas. Cependant, si tu y viens, tu verras que le débat, c’est du concret et cela permet de retourner discuter autour de soi et d’alimenter les débats.
Je termine en citant ce texte écrit par un révolutionnaire il y bientôt 80 ans et qui en dit long sur les problèmes actuels :
« Ce n’est pas une crise de conjoncture, mais une crise sociale. Notre parti peut jouer un rôle important. Ce qui est difficile pour un jeune parti évoluant dans une atmosphère lourde de traditions précédentes d’hypocrisie, est de lancer un mot d’ordre révolutionnaire. « C’est fantaisiste ». « Ce n’est pas adéquat en Amérique ». Mais il est possible que cela changera lorsque vous lancerez les mots d’ordre révolutionnaires de notre programme. Il y en a qui riront. Mais le courage révolutionnaire ne consiste pas seulement à être tué, mais à supporter le rire de gens stupides qui sont en majorité. (...)
Question : L’idéologie des ouvriers ne fait-elle pas partie des facteurs objectifs ?
Trotsky : (...) La mentalité c’est l’arène politique de notre activité. Nous devons donner une explication scientifique de la société et l’expliquer clairement aux masses. C’est là la différence entre le Marxisme et le Réformisme. »
Salut les amis
6. Quelques questions sur l’argent. , 27 octobre 2008, 19:35, par F. Kletz
1 à quoi sert l’argent socialement ?
2 Historiquement, d’où vient l’argent ?
3 comment cela se fait que, tous les jours, entend dans les médias qu’il manque de liquidités alors qu’il existe des usines de production des billets et des pieces ?
4 pourquoi l’état finance les banques et pas les ouvriers, les travailleurs de tous bords, les pauvres, qui en ont besoin ?
pourquoi l’état donne des milliards aux banques alors que des prolétaires se retrouvent à la rue, ont faim et demandent à financer leur repas ou leur chambre dans le métro ?
5 Pourquoi les prix augmentent ? pourquoi les prix baissent ?
6 Qu’est-ce qui existait dans la société de classe comme équivalent général ?
Qu’est-ce qui existait comme types d’échanges avant l’invention de l’argent ?
7 pourquoi paye-t-on en billets et en pièces et pas en or, pas en diamants, par en corries, pas en sel, etc. ?
8 l’état cautionne des milliards pour les banques, d’où est-ce qu’il sort cet argent-là ?
9 pourquoi un café coûte 2€ ? qu’est-ce qui détermine le prix d’une marchandise ?
10 qu’est-ce qui détermine que le salaire, le smic, par exemple, qui est à 8,71€ ?
11 Pourquoi ces questions ne sont jamais posées à l’école, ou très peu abordées ? Pourquoi souvent, si cela arrive d’aborder ces questions, les réponses, s’il y en a, restent évasives ?
En fait, toutes ces questions-là, mine de rien, se posent partout ou commencent à se poser partout tout autour de nous, donc je vais tenter d’y répondre d’une manière peut-être tordue, peut-être incomplète, mais je pense que c’est très important d’essayer de donner une réponse à ces problèmes.
Ce sont des réalités de tous les jours pour n’importe quel ouvrier, travailleur, ou chômeur.
Amitiés
F. Kletz
7. Quelques questions sur l’argent. , 3 novembre 2008, 01:09, par F. Kletz
Premiers éléments de réponse.
Question 1 : A quoi sert l’argent socialement ?
L’argent sert aux échanges. En fait, il sert surtout à ce que les diffuseurs de produits, les commerçants fassent de l’argent. Une commission qu’ils empochent sur un produit. Et pour les fabricants, pareil.
Par exemple, un commerçant vend 1000 produits à 20€, il se fait une commission de 15% par exemple, il empoche 20 000 x 0,15 soit 3000€. Bon, là-dessus, il faut qu’il paye son employé, son électricité, tous ses frais, rembourser l’achat du magasin, etc.
Mais les produits, il les a achetés. Aujourd’hui, c’est plutôt un vendeur de l’usine lui a mis à disposition dans son magasin. Et c’est là que le plus gros de l’argent circule. Les 17 000 euros restant, hop, c’est l’usine qui les touche. Et comme elle a des commerçants qui vendent son produit dans toutes les villes, il faut multiplier par le nombre de villes les 17 000 euros qu’elle touche. Voilà à quoi sert l’argent d’une boîte de conserve, d’un morceau de fromage ou de n’importe lequel des produits trouvés à la supérette du coin ou au supermarché : ça sert pour l’ouvrier à manger son déjeuner sur sa pause casse-croute, mais ça sert surtout au fabriquant à toucher un beau magot à la clef quand tous les ouvrier du quartier auront été acheté la boîte ou le fromage, ça lui aura rapporté pas mal.
Donc, pour l’ouvrier, ça fait qu’il peut s’acheter son repas, pour le commerçant, le propriétaire de la supérette, su supermarché, ça lui sert à toucher sa marge, pour le fabriquant, ça sert à gagner un max d’argent, un beau magot.
Ce magot, il va le réinvestir soit pour fabriquer d’autres boites de conserve, soit pour fabriquer d’autres produits. Au final, tout cela lui servira à recommencer la même opération. Ainsi, on peut dire que pour l’ouvrier, pour le salarié, l’argent sert à vivre (payer son loyer, s’acheter son repas, se procurer des loisirs, café, cinéma, livre, DVD, etc.) ; tandis que pour le capitaliste (fabriquant ou commerçant) l’argent sert à faire de l’argent.
8. Quelques questions sur l’argent. , 11 novembre 2008, 14:37
qu’est-ce ce que l’argent ? Comment fonctionne le capital et son accumulation , etc etc ... ? Quelle est la fonction-de l’argent ? .. Tout le monde pense le savoir : c’est le moyen de développer les échanges. c’est le fric.. ? C’est la sueur de ton front donc ton travail. Et le capital.. ? C’est le vol d’une partie du temps de ton djob, donc de la sueur de ton front. ..l’accumulation du capital donc de l’argent de l’or du diamant de toute sorte de formes de choses d’échangeurs ? c’est l’entassement des millions de mètres cube de sangs et de sueur de nos front sur toute la planète pendants des siècles ..mon café coûte cher ? parce que les prolos de fonction différent on mis du temps a le produire. ..la cherté ou la non chertés des marchandises donc les prix ? le prix d’une marchandises est déterminée par le foutu temps que les travailleur on mis pour sa production etc etc ..l’analyse de l’économie pur sans les hommes ? faites un tour du site et cherchez à savoir ce que disaient les anciens révolutionnaires là dessus.
merci les amis a bientôt sur d’autre sujet
9. Quelques questions sur l’argent. , 7 avril 2009, 20:41
Article du « Financial Times » du 3 avril 2009, qui s’intitule lui-même « journal du business » :
« Ce que la Révolution française peut apprendre à l’Amérique
« Il faut bouffer du riche ! », les termes féroces utilisés par certains manifestants la veille di sommet du G20 à Londres évoquent les pires excès de la Révolution française. La colère anti-capitaliste à l’Ouest ne se limite pas à l’Europe. (…) Certes, l’Amérique de 2009 n’est pas la France de 1789, peu avant la prise de la Bastille (cette prison qui symbolisait la nature oppressive du régime monarchique et dont la chute a symbolisé le début de la révolution). La chute de la banque Lehman Brothers, en septembre 2008, n’a rien de commun avec la prise de la Bastille et les symboles du profit ne devraient pas être confondus avec des symboles d’oppression. Il n’y a pas de guillotine qui nous attend au coin de la rue et il faudrait beaucoup d’imagination pour comparer le président Barack Obama à Louis XVI, ou Michelle Obama à Marie-Antoinette.
Cependant, (…), je sens la peur, l’anxiété et un profond sentiment d’injustice, comme à la veille de la Révolution française. Il suffit de remplacer les expulsions de paysans par les enclosures par les licenciements, les aristocrates par les banquiers, et les nobles privilégiés par les aristocrates de la finance qui n’ont pas à payer d’impôts pour leurs stock-options. (…)
L’explosion de révolte populaire qui a accompagné le scandale de l’assureur AIG (…) dévoile la souffrance de l’Amérique profonde. Le peuple de la rue est aussi scandalisé que l’étaient le petit peuple de France au 18ème siècle. La peur pour leur présent et pour leur avenir se combine à la colère contre ceux qu’elle considère comme les responsables de la crise et qui en subissent beaucoup moins les conséquences. Les dirigeants des banques d’aujourd’hui ne sont-ils pas comme les aristocrates d’hier, eux dont les privilèges ne sont plus justifiés par leurs fonctions sociales. Les uns n’avaient plus la fonction d’être les seuls à défendre leur roi avec leur épée et les autres n’ont plus celui de créer et de distribuer les richesses.
Le problème avec l’équipe en économie du nouveau président, c’est que, comme la cour du roi de France dans la période pré-révolutionnaire, il a hérité tous les mauvaises habitudes de l’Ancien régime, mêlant une sympathie excessive pour la logique dépassée du monde de la finance, qu’il a aidé à construire, à une insensibilité aux émotions des gens ordinaires, qu’il tâche d’ignorer. (…)
Si Obama échoue, l’ensemble des lois économiques actuelles d’aujourd’hui va se retrouver en face de la même destinée tragique que celle qui a frappé les droits féodaux de l’Ancien régime. »
2. Nouvelle crise mondiale et limites du capitalisme, 1er octobre 2009, 12:45, par Robert Paris
A lire ....
sur les crises
3. Nouvelle crise mondiale et limites du capitalisme, 8 novembre 2009, 12:21, par Yves Coleman - Ni patrie ni frontières
De quelques clichés gauchistes sur les "crises"
28 octobre 2009
Les luttes de classe (ou pour être plus clair les rapports de force entre la classe ouvrière d’un côté, l’Etat et les patrons de l’autre) se mesurent avec des instruments relativement précis, même si le plus souvent l’extrême gauche et les libertaires se contentent de réflexions impressionnistes et imprécises :
1) l’outil de base, le plus évident, est le nombre de jours de grève par an - après on affine en fonction des secteurs concernés, des objectifs des grèves, des formes de lutte et de l’issue de ces conflits
2) les manifestations de rue, leur ampleur, leur fréquence, leurs objectifs, éventuellement les affrontements avec la police et encore une fois l’issue des manifs
3) les émeutes, les affrontements violents (armés ou pas, organisés ou pas) avec l’Etat, les couches sociales concernées. Un affrontement, aussi “violent” soit-il, de petits commerçants français et poujadistes avec des flics n’a pas la même portée qu’une manif de 50 000 Indiennes de la COB bolivienne.
4) l’évolution des effectifs des organisations syndicales et politiques qui se réclament des travailleurs.
5) la contestation des bureaucraties "ouvrières" par les travailleurs et les formes - organisées ou pas - prises par cette contestation
6) éventuellement, même si c’est une conséquence secondaire et “déformée” des conflits entre classes, les résultats électoraux pour la gauche et l’extrême gauche, la portée de l’abstention, du vote blanc, etc.
7) la nature des régimes politiques et les conditions politiques générales : parler de “lutte de classe” sous la dictature nazie, sur le front russe pendant la bataille de Stalingrad, ou en ce moment à Bagdad n’a pas le même sens que dans un régime démocratique et en l’absence de tout conflit armé.
Il y a certainement bien d’autres critères qui ne me viennent pas immédiatement à l’esprit mais qu’il faudrait utiliser si l’on voulait discuter précisément de telle ou telle situation (par exemple les grèves de 1995).
Dans un pays comme la Suisse ou l’Autriche, le niveau de la lutte des classes n’est pas le même que celui de la France. Et celui de la France entre juillet et novembre 2006 n’est pas le même que celui d’Oaxaca à la même période. Tout cela peut se mesurer de façon assez précise avec les outils ci-dessus mentionnés.
Si l’on n’étudie pas concrètement la situation spécifique de chaque pays, et chaque mouvement on ne tient que des discours généraux et généreux qui peuvent être (un temps) bons pour le moral mais qui, à moyen et à long terme, ne mènent qu’à la démoralisation, à des pratiques aventuristes fondées sur des analyses erronées ou à la récitation de mots d’ordre creux, qui n’ont pas plus d’effets sur la réalité sociale que les prières ou les mantras.
Cela suppose de ne pas présenter pas chaque lutte défensive locale comme le début d’une grande offensive nationale ; de ne pas confondre une journée d’action des fonctionnaires avec une grève générale des salariés ; ou de ne pas faire passer des “émeutes de banlieue” pour une “insurrection” (Besancenot).
L’intérêt de différencier une simple grève d’une crise sociale, une crise sociale d’une crise politique, une crise économique d’une crise sociale ou politique, une crise politique d’une crise pré-révolutionnaire, c’est de ne pas prendre ses désirs pour des réalités et d’acquérir une certaine crédibilité politique.
Par exemple, on peut dire que les émeutes de novembre 2005 ont été le reflet d’une crise sociale latente ; qu’elles ont donné lieu à une explosion sociale limitée (dans le temps et dans l’espace, mais aussi par sa nature politique) ; qu’elles ont provoqué une crise politique finalement très réduite, mais qu’il ne s’agissait en aucun cas d’une crise pré-révolutionnaire, où les gens commencent à poser –explicitement ou non - le problème du pouvoir, pas simplement d’un changement de régime. Quand Besancenot parle à propos des émeutes de 2005 d’une “insurrection”, il fait preuve de démagogie.
L’extrême gauche confond violence défensive et violence offensive, affrontements armés et révolution (“les travailleurs mexicains ont effectivement pris les armes à de nombreuses reprises” écrit un internaute gauchiste, mais dans quelles conditions concrètes, à quelle échelle, et avec quels résultats ? Que je sache, il n’y a jamais eu ni soviets ni conseils ouvriers en Amérique latine, raison pour laquelle le néostalinisme et le militaro-populisme y sont aussi influents encore aujourd’hui ; quant aux zapatistes il s’agissait au départ d’un groupe mao-stalinien parti dans les campagnes pour organiser les paysans et répéter les mêmes erreurs que dans les années 60, puis qui a évolué vers des positions plus réalistes, et sans doute aussi réformistes, mais qui n’a pas d’influence sur la classe ouvrière mexicaine à l’échelle nationale et surtout dont les campagnes n’arrivent pas à faire la jonction avec d’autres luttes de la classe ouvrière).
Ce n’est pas parce que des grévistes affrontent l’armée ou la police avec des manches de pioche ou même des armes qu’il y a automatiquement une situation révolutionnaire. La COB bolivienne a utilisé de la dynamite contre l’armée à de nombreuses reprises. Aux Etats-Unis il y a eu de nombreux affrontements armés avant la Première guerre mondiale dans des conflits sociaux, sans que cela débouche sur la moindre situation révolutionnaire. Au Venezuela il y a des manifs monstres pour défendre le régime, il y a même deux polices politiquement opposées à Caracas, un million de gens se sont inscrits dans les milices de Chavez, mais il n’y a pas la moindre situation de double pouvoir. Et pour cause tout le processus est contrôlé par les sommets de l’armée et de l’Etat, les exploités n’ont aucune envie, pour le moment, de véritablement prendre leur sort entre leurs mains, ils sont encore dans le culte du chef providentiel, du Caudillo et n’ont pas confiance en leurs propres capacités. Et ce n’est pas le paternalisme et l’autoritarisme des chavistes qui leur fera prendre de l’assurance.
De même l’extrême gauche confond souvent la question du “pouvoir” avec celle d’un changement de régime. Certains pays connaissent de nombreux coups d’Etat mais pas la moindre situation de double pouvoir. Les mouvements de résistance en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale ont certes abouti à des affrontements armés, mais qui ont seulement renversé des régimes fascistes (Italie, France, Grèce) qui ont été remplacés par des régimes démocratiques bourgeois ou totalitaires-staliniens (Yougoslavie). Pas la moindre trace de situation révolutionnaire ou pré-révolutionnaire sinon dans l’imagination de l’extrême gauche. Et pourtant l’Etat fasciste ou collaborationniste a souvent été abattu par la force...
En dehors de la question de la “violence”, qui est souvent considérée (et sans aucun souci de précision) comme LE critère décisif, il y a bien d’autres facteurs qu’il faut prendre en compte pour déterminer le niveau de gravité d’une crise sociale, politique ou économique et ses répercussions.
En 1953, en France, il y a eu une crise sociale très dure, dans le secteur public du moins, mais elle n’a débouché sur aucune crise révolutionnaire.
Le coup d’Etat de De Gaulle en 1958 a coïncidé avec une grave crise politique, mais il n’a eu aucune dimension sociale importante (pas de grève générale, ni même de grèves dures contre le changement de régime).
En 1968 il y a eu une crise sociale et une crise politique graves mais qu’il ne s’agissait pas d’une crise pré-révolutionnaire. A aucun moment les travailleurs n’ont cherché à remettre en cause la propriété privée en occupant massivement les usines (c’est pourquoi il me semble inexact d’affirmer que la “classe ouvrière posait concrètement le problème du pouvoir dans chaque entreprise”). Les occupations d’usines étaient ultra-minoritaires et chapeautés par des petits groupes de bureaucrates syndicaux et de militants PCF que l’on enfermait ainsi dans les usines pour éviter la contamination de la jeunesse et des étudiants. Rien à voir avec les occupations massives et “festives” de 1936, qui elles-mêmes n’ont pas non plus créé de situation révolutionnaire contrairement à la légende trotskyste.
Quant aux comités d’action de 1968, ils étaient créés sur la base des quartiers ou des facs, pas des usines, et s’ils regroupaient beaucoup plus que les "gauchistes" encartés, ils n’ont organisé qu’une toute petite frange des travailleurs et surtout des salariés "marginaux" ou “périphériques” par rapport au "coeur" de la classe ouvrière (surtout des jeunes non syndiqués, ou alors des plus âgés mais travaillant dans des petites boîtes).
Il y a eu une crise économique très grave au Venezuela (après la dévaluation du bolívar en 1983) et il n’en est résulté aucune crise sociale importante dans les six ans qui ont suivi (le Caracazo, émeute réprimée dans le sang, date de 1989).
Le Panamá a connu une crise économique et politique très grave après l’intervention américaine en 1989 mais aucune crise sociale qui se serait traduite par des émeutes ou des grèves de masse. Et plus de 17 ans après les travailleurs panaméens continuent à encaisser des coups.
Lors de l’anniversaire de l’insurrection hongroise en octobre 2006 il y a eu une crise sociale et politique à Budapest, mais les prolétaires ont été massivement absents des rues - et heureusement parce que c’était l’extrême droite qui tenait le haut du pavé contre les flics et qui lançait les mots d’ordre !
Donc il n’y a aucun lien mécanique et automatique entre les différentes formes de crise (économique, politique et/ou sociale), et une crise pré-révolutionnaire ou révolutionnaire. Il faut à chaque fois être précis et concret, et ne pas se contenter de formules ahistoriques et intemporelles, ni d’une panoplie de mots d’ordre fabriqués à l’avance.
Y.C.
(2007)
1. Nouvelle crise mondiale et limites du capitalisme, 11 mars 2010, 10:38, par MOSHE
Les capitalistes estiment que le système n’est pas seulement en crise mais ne fonctionne déjà plus et que cela va bientôt devenir évident aux yeux de tous, provoquant une panique de grande ampleur !
2. Nouvelle crise mondiale et limites du capitalisme, 17 décembre 2010, 12:46, par MOSHE
Un système fondé sur le profit privé et qui ne survit plus qu’à coups de distributions régulières et massives d’argent public est un système fini.
4. Nouvelle crise mondiale et limites du capitalisme, 21 janvier 2015, 07:03, par R.P.
Voici ce qu’écrit Le Point commentant "Croissance zéro - Comment éviter le chaos ?" de Patrick Arthus :
Croissance zéro (éd. Fayard) s’appuie sur des faits incontestables et inquiétants. Les efforts de recherche et développement des grands laboratoires pharmaceutiques et des groupes de semi-conducteurs sont de plus en plus coûteux, mais ne débouchent plus sur des découvertes majeures. Bref, les chercheurs cherchent, mais ne trouvent plus ! Les problèmes de formation, de mise à jour des compétences sont particulièrement criants en France. Ils n’ont fait que croître depuis vingt-cinq ans...
Après une première partie pessimiste, les auteurs qualifient de "nouvelle ère" la période dans laquelle nous nous engouffrons. Dès que les hommes politiques, les partenaires sociaux et certains chefs d’entreprise auront pris conscience que plus rien ne sera comme avant, ils se lanceront dans une politique d’adaptation dont les contours et les priorités sont connus, même si, au regard de nos concurrents de l’OCDE, "la situation française est toutefois particulièrement préoccupante".
Il faudra donc à notre pays une thérapie de choc composée de dix mesures prioritaires. Il serait trop long de les énumérer ici, contentons-nous des plus radicales ! Baisse du smic, convergence progressive entre CDD et CDI, report immédiat d’un an de l’âge de la retraite pour tous ou établissement d’une politique monétaire favorable aux emprunteurs avec des taux d’intérêt réels durablement bas. Certes, nous avons vu finir un monde ancien, mais il ne faut pas avoir peur de celui qui s’ouvre devant nous. Croissance zéro est un hymne à la lucidité, au courage et, en creux, à l’action politique...
Voilà à quoi réfléchit la bourgeoisie : comment faire payer les travailleurs et comment les piéger politiquement et socialement pour éviter... la révolution....
5. Nouvelle crise mondiale et limites du capitalisme, 11 février 2015, 21:11
A Londres, le Daily Telegraph écrit : « Le 13 octobre 2008 restera dans l’histoire comme le jour où le système capitaliste britannique a reconnu avoir échoué. »
6. Nouvelle crise mondiale et limites du capitalisme, 14 février 2015, 08:33
Les hypothèques à haut risque, baptisées « subprimes » par les anglophones sont en voie d’effectuer un retour en 2015.
Selon la formule, les institutions financières accordent des prêts hypothécaires à ceux qui n’ont pas la cote de crédit pour se qualifier pour un prêt de premier rang. Le taux d’intérêt est plus élevé et le prêt n’est pas garanti par un gouvernement.
Selon ce que rapporte l’agence Bloomberg, les analystes de la banque américaine JPMorgan Chase prévoient que 5 milliards $ US de transactions auront lieu avec ces hypothèques en 2015.
Des fonds privés comme Seer Capital Management et Angel Oak Capital, ainsi que la banque australienne Macquarie Group, font partie des groupes qui achètent présentement ces prêts.
Chez Angel Oak, des prêts ont une durée de 30 ans avec un taux fixe de 8 %. Et ce même si les taux américains tournent autour de 3,6 %.
Ces actifs risqués pour un bilan bancaire sont ensuite convertis en titres de placement et possiblement vendus à des investisseurs.
Les institutions impliquées dans les nouveaux « subprimes » essaient de raviver le marché sans répéter les erreurs qui ont causé l’effondrement économique américain en 2008. Elles conserveraient les titres les plus risqués pour elles-mêmes, alors qu’auparavant Wall Street les avait refilés à des clients.
Juste avant la crise, soit de 2005 à 2007, 2000 milliards $ de titres liés aux « subprimes » ont été émis par les institutions financières, selon Inside Mortgage Finance.
7. Nouvelle crise mondiale et limites du capitalisme, 28 février 2015, 07:02
Les autorités américaines mènent une enquête contre l’agence de notation Moody’s Investors Service, qu’elles soupçonnent d’avoir surévalué des produits financiers adossés aux prêts immobiliers "subprime" à l’origine de la crise financière, rapporte ce dimanche le Wall Street Journal (WSJ).
Si cette investigation est confirmée, Moody’s deviendrait la deuxième grande agence de notation dans la ligne de mire du département américain de la Justice (DoJ) après Standard & Poor’s (S&P). Un accord entre le DoJ et S&P, comprenant une amende 1,37 milliard de dollars, pour mettre fin aux poursuites est imminent.
Il est curieux d’enquêter maintenant sur des responsables de la crise de 2007 !
8. Nouvelle crise mondiale et limites du capitalisme, 22 mars 2015, 08:51
Le principal indice boursier américain, le Dow Jones, valait 14 000 points avant la crise en 2007. Il a été divisé par deux avec la crise, tombant à 7000. Mais il est remonté dès le début 2009 pour dépasser aujourd’hui les 18 000 points.
Cette euphorie boursière reflète-t-elle des profits faramineux et une économie radieuse ? La réponse est clairement non. Après avoir atteint un plancher dans les années 1980, le taux de profit ne s’est jamais redressé significativement malgré le tournant « néolibéral ». Depuis 1997, il baisse de nouveau tendanciellement3. Les bulles financières reflètent depuis lors l’abondance d’argent, alimentée par des politiques monétaires expansionnistes, qui ne trouve pas à s’investir de façon rentable dans « l’économie réelle ».
La nouvelle bulle financière trouve sa source dans la politique de quantitative easing (QE) lancée aux USA dès la fin 2008. Cette politique consiste pour une banque centrale à acheter des titres financiers sur les marchés et à créer en contrepartie de la « monnaie centrale », c’est-à-dire à alimenter les réserves monétaires des banques commerciales.
Mais cet afflux de liquidités n’a pas eu d’effet miraculeux. Le crédit pour la production est resté atone, car il ne suffit pas d’imprimer du papier monnaie pour sortir de la crise de rentabilité du capital. Ces liquidités sont donc restées dans la sphère financière et ont provoqué une forte inflation financière. Finance et économie réelle sont néanmoins connectées : les titres financiers représentent des droits de tirage sur la production future, et c’est pourquoi les bulles financières finissent toujours par éclater.
Une première bulle a ainsi éclaté à la fin des années 1990, une seconde en 2007, et une troisième ne demande qu’à connaître le même destin. Aujourd’hui, la stagnation des profits aux Etats-Unis et la crise du pétrole de schiste indiquent que l’échéance pourrait être proche. Depuis octobre 2014, les marchés financiers sont très volatils et nerveux, comme ils le sont en général avant un krach.
9. Nouvelle crise mondiale et limites du capitalisme, 22 mars 2015, 08:59
En ce qui concerne les taux d’intérêt, « l’ampleur de la baisse allume un signal d’alarme », selon l’OCDE qui craint un aveuglement des marchés, éblouis par les liquidités énormes qui affluent vers eux. « Une mauvaise estimation du risque a été au coeur de la précédente crise financière et il semble bien que ce phénomène ressurgisse aujourd’hui », s’inquiète l’OCDE.
Le FMI s’inquiète également régulièrement des prises de risque peut-être inconsidérées de nombreux investisseurs sur les marchés et de la valorisation très forte de certains actifs, ce qui pourrait provoquer de sévères corrections. Mais sa patronne, Christine Lagarde, se refuse jusqu’ici à parler de bulle.
A la veille des crises financières, les hauts responsables sont dans le déni, ne voulant pas apparaître comme des oiseaux de mauvais augure quand les profits s’amoncellent !
10. Nouvelle crise mondiale et limites du capitalisme, 23 mars 2015, 08:10
C’est la peur, plutôt que l’euphorie, qui conduit actuellement les marchés boursiers mondiaux à de nouveaux sommets, a affirmé dimanche le prix Nobel d’économie américain Robert Shiller, dans un entretien à un journal allemand.
Robert Shiller, professeur à l’Université de Yale, a également mis en garde sur de possibles bulles boursières et estimé que ce pourrait être le bon moment d’investir dans le pétrole, compte tenu de l’actuelle faiblesse record des prix.
"Le boom des marchés boursiers que nous connaissons actuellement n’est pas entraîné par l’euphorie", a déclaré l’économiste au Frankfurter Allgemeine Sonntagzeitung.
"Je l’appelle le +nouveau boom normal+. C’est un boom d’investissement (...) Tous les mécanismes sont là, mais il manque la conviction", a-t-il dit.
"Nous ne voyons pas trace d’optimisme. Ce boom est conduit par la peur", a-t-il encore assuré.
Comme Wall Street, les Bourses européennes ont terminé la semaine dans le vert, plusieurs places battant des records vendredi, grâce au discours jugé accommodant de la Réserve fédérale américaine deux jours auparavant et à l’apaisement des craintes liées à la Grèce.
"Il n’y a pas beaucoup d’alternatives aux marchés boursiers pour le moment. Nous sommes dans une période de taux d’intérêt extrêmement bas", a relevé Robert Shiller.
Afin de relancer l’économie moribonde en zone euro, la Banque centrale européenne (BCE) a réduit ses taux d’intérêt au plus bas et lancé un vaste programme de rachats de dettes publiques et privées.
Face à cet afflux de liquidités, certains critiques ont mis en garde contre le danger de bulles spéculatives, boursières ou immobilières, qui pourraient bientôt éclater.
"Je pense qu’il y a des bulles", a déclaré l’économiste, mais selon lui les banques centrales ne sont pas à blâmer.
La BCE "n’est pas responsable des faibles taux d’intérêt", mais plutôt le pessimisme mondial, a-t-il estimé.
11. Nouvelle crise mondiale et limites du capitalisme, 6 juillet 2015, 07:44
Toutes les places financières d’Asie ont entamé et achevé cette journée de lundi dans le stress, minées par les mauvaises nouvelles en provenance de Grèce . En séance dans la journée ou à la clôture, aucune grande Bourse de la région ne s’affichait dans le vert. Au Japon, le Nikkei a achevé la première séance de la semaine en recul de 2,9%, tandis que Hong Kong chutait de 3,6% en seconde partie de journée. A Shanghai, les actions dévissaient plus encore, de plus de 7%. Même instabilité sur le plan des changes. Lors des premières transactions de la matinée, l’euro diminuait de 2% environ, et le contexte d’aversion au risque fragilisait d’autres devises asiatiques. A l’image du ringgit malaisien, au plus bas depuis près de dix ans. Le yen japonais, au contraire, faisait figure de valeur refuge, comme à chaque crise financière mondiale, et repartait à la hausse face aux grandes monnaies occidentales.
12. Nouvelle crise mondiale et limites du capitalisme, 28 janvier 2016, 07:18
La Réserve fédérale américaine (Fed) a fait part, mercredi 27 janvier, de sa préoccupation à propos des turbulences financières actuelles et du ralentissement de la croissance mondiale. À l’issue d’une réunion de deux jours de son Comité de politique monétaire, la banque centrale a laissé ses taux directeurs inchangés. Malgré un discours un peu plus pessimiste que celui adopté en décembre, lors de la précédente réunion, la Fed continue toutefois de prévoir un relèvement « graduel » de ses taux au cours des prochains mois.
Après avoir relevé les taux directeurs pour la première fois en neuf ans, il y a six semaines, la Fed a donc légèrement changé de ton. « La croissance économique [aux États-Unis] a ralenti à la fin de l’année », constate-elle dans son communiqué. Par ailleurs, « Le Comité surveille étroitement l’économie mondiale et les développements financiers et évalue leurs implications sur le marché du travail et l’inflation » aux États-Unis, souligne-t-elle. Un diagnostic qui a fait l’objet d’une unanimité au sein du Comité.
La Fed semble avoir de plus en plus de difficultés à jauger l’impact sur l’économie américaine de la baisse du pétrole et du ralentissement dans un certain nombre de pays, à commencer par la Chine. Malgré les progrès réalisés sur le marché de l’emploi, la bonne tenue de la consommation et la reprise du marché immobilier, l’économie américaine est menacée de l’extérieur. Les turbulences sur les marchés financiers pourraient être de nature à saper la confiance des ménages et des entreprises, tandis que la montée du dollar commence à miner les exportations.
13. Nouvelle crise mondiale et limites du capitalisme, 18 août 2018, 09:28
À l’approche du dixième anniversaire de la crise financière mondiale de 2008, la tourmente qui engloutit la lire turque démontre que toutes les conditions à l’origine du krach sont toujours là.
En fait, les mesures mêmes prises par les gouvernements et les banques centrales des principaux pays capitalistes pour faire face à l’effondrement les ont aggravées. Cela a ouvert la voie à une nouvelle catastrophe financière, potentiellement pire que celle d’il y a dix ans.
L’injection de milliers de milliards de dollars sur les marchés financiers mondiaux et le régime de taux d’intérêt ultra-faible qui l’accompagne avait donné un coup de fouet aux mêmes sociétés financières dont les activités spéculatives ont provoqué le krach. Maintenant ces mesures ont construit un nouveau château de cartes financier.
À un degré à peine imaginable en 2008, toutes les grandes économies du monde sont enfermées dans un cycle de guerre économique en perpétuelle escalade. Cette guerre commerciale mondiale est menée par la Maison-Blanche de Trump, qui voit les sanctions et les tarifs commerciaux, telle que les attaques lancées contre la Turquie, comme partie intégrante de sa volonté de protéger les intérêts géopolitiques et économiques des États-Unis au détriment de ses amis et ses ennemis.
La nature de l’économie mondiale a subi une transformation majeure au cours de la dernière décennie au cours de laquelle la croissance économique, dans la mesure où elle se produit, ne dépend pas du développement de la production et des nouveaux investissements, mais saute d’une activité parasitaire à l’autre.
En conséquence, l’argent a afflué sur les marchés dits émergents, tels que la Turquie, où la perspective de taux de rendement et de croissance plus élevés résultant de la capacité des gouvernements et des sociétés à contracter des prêts en dollars et d’autres devises à des taux très faibles a fourni l’occasion de faire des profits rapides.
L’ampleur de ce flux d’argent est indiquée par les chiffres compilés par l’Institut de Finance internationale. Selon ses données, l’endettement combiné de 30 grands marchés émergents est passé de 163 % du produit intérieur brut à la fin de 2011 à 211 % au premier trimestre de cette année. En termes monétaires, cela représente une augmentation de quarante mille milliards de dollars des dettes des économies émergentes.
Tant que les taux d’intérêt et la valeur du dollar américain restaient bas, ce processus pouvait se poursuivre. Mais la décision de la Réserve fédérale américaine de hausser les taux d’intérêt et de mettre fin à son programme d’assouplissement quantitatif et le mouvement de hausse du dollar qui en résulte font que le fardeau de la dette en dollars augmente rapidement. Cela a provoqué une ruée vers la sortie, dans laquelle la livre turque a plongé de près de 40 % cette année.
Mais la crise turque n’est que l’expression la plus frappante jusqu’à présent d’un développement beaucoup plus répandu. Le rand sud-africain a chuté de près de 10 %, le réal brésilien a subi des pressions à la baisse cette année et cette semaine, la roupie indienne a atteint son plus bas niveau historique par rapport au dollar américain. Avec l’éclatement de la crise turque, l’Argentine, qui a sollicité en juin une aide d’urgence du Fonds monétaire international pour tenter de freiner la chute du peso, a haussé son taux d’intérêt de la banque centrale de 5 points de pourcentage, atteignant 45 %, pour tenter de stopper l’hémorragie financière.
Les turbulences dans les économies émergentes ressemblent de manière frappante à la crise financière asiatique de 1997-98, lorsque l’effondrement du baht thaïlandais avait provoqué une chute des monnaies dans la région. Décrite par le président américain Bill Clinton comme un simple « pépin » sur la voie de la mondialisation, la crise asiatique a entraîné une profonde récession dans la région. Cela a entraîné à son tour une crise du rouble russe qui a joué un rôle central dans l’effondrement du fonds d’investissement américain Long Term Capital Management, qui a été alors renfloué par la Réserve fédérale de New York parce qu’il y avait des craintes que sa faillite provoque un effondrement du système financier américain au complet.
14. Nouvelle crise mondiale et limites du capitalisme, 21 septembre 2018, 08:24
Des études de l’OCDE annoncent la fin de la reprise !!! Mais on n’avait pas vu de reprise du tout !!!